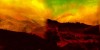1
Quelques cailloux épars.
Une fontaine qui ruisselle.
Deux ou trois rochers, montagnes lilliputiennes.
Une branche aux prétentions d’arbre.
Le murmure du vent, discret, invente la tempête…
Le regard se perd dans ces immensités.
Un regard en cercle suffit pour saisir mon domaine. Comme un oiseau ramassé sur le bord de la route, et tenu dans la paume qu’il réchauffe. Il y a plus d’amour, souvent, dans un arbuste aimé que dans une ville (fut-elle de lumière) L’intention est tout, la forme est illusoire.
Quelques cris d’insectes. Quelques chants d’oiseaux. Le mouvement d’une feuille déplacée par le vent. Un grain de raisin trop mûr tombe. Peut-être est-ce possible… Je ne le sais. Ma mémoire est ludique. Je me baisse, regarde une fourmi tardive (le mot juste doit être retardataire) mais j’aime ce mot, sa sonorité, comme une caresse. L’idée aussi me séduit. Une saison tardive. Un fruit tardif. Comme un bonheur que l’on n’espérait plus. Je me penche, les genoux en terre, plantés comme deux légumes insolites. L’herbe est une savane pour la fourmi – Pour moi, elle est une planète. Tout vient du regard… Le grand comme l’infime. Le désert doit être beau mesuré grain par grain. Une galaxie remplace un atome.
…
Je ne peux arrêter de fumer. Je le pourrais, sans nul doute… Mais la fumée qui s’envole est une magicienne. Peut-être est-ce mon goût pour les jeux du hasard. La liberté de la matière me fait croire en la mienne.
Il y aura une autre histoire. Un tableau prendra corps au fond de mon regard. Bientôt la nuit. Je vais rester assis. Attendant. J’aime l’histoire de l’arbre. Je ne connais son nom. J’aime sa voix muette. Je connais l’or du ciel lorsque tombe le jour.
Une voiture au loin. Un chien grogne dans son sommeil. Un hérisson se hâte. Mon ami le crapaud n’aura plus jamais peur. Je connais sa souffrance. Mais jamais elle ne sera mienne. Parfois, lorsque l’amour domine, je voudrais prendre en moi la souffrance du monde. Nous avons de ces héroïsmes !
Bruit de cascade au ralenti, soupir du temps qui fuit. Très lentement, comme à regret, des gouttes s’échappent d’un robinet ! Avez-vous déjà, observé le saut suicidaire d’une goutte ? Au commencement, métal et eau sont liés comme deux œufs jumeaux puis la goutte se détache, non pas tout à fait mais comme un enfant naissant qui cherche sa forme définitive. Enfin, la goutte tombe. Le métal orphelin reste… solitaire. Mon esprit chemine. Pas en droite ligne mais butinant. Il y a de l’abeille en moi… Ainsi que du renard. En matière de butin, les poules et les images pourraient être sœurs. Orphée est toujours orphelin de son double. Je ne me souviens plus de son nom : Eurydice ou goutte d’eau anonyme ?… Quelle importance, au fond ? La solitude reste l’énigmatique réponse à toutes nos inquiétudes.
…
Jour de pluie. Les pierres dansent sous les gouttes. Bientôt l’orage illumine le ciel. J’aime l’odeur de la pluie. La terre monte jusqu’aux narines (par son parfum seulement) La vie est un créateur perpétuel, contrairement à l’homme, machine pensante et éphémère. Il y aura d’autres soirs et puis d’autres matins… Tous seront l’unique.
Une femme inconnue danse solitaire. L’arbre ne sera plus en fleurs, ses racines ont fui. Le saumon remonte à la source et meurt. L’éternité est à ce prix.
L’eau, toujours, me hante. Lac sous la glace. Le printemps revient. La lumière du soleil tombe (suivant un plan précis) sur l’axe de la terre. Un oiseau chante la nature endormie. La glace se rompt. Respiration de l’eau. Bruits de pas dans le lointain. Rivière d’automne. Mouvement liquide. Soleil et pluie mêlés. La terre et l’eau s’épousent. Nulle recherche d’originalité. La fusion est à ce prix. La vie est le seul art fertile.
Torrent en été, à sec. Quelques cailloux en place d’océan. Un filet d’eau froide contre la chaleur du jour. La montagne au loin garde la mémoire du monde. Une femme attend. Seule mais non solitaire. La présence (ou l’absence) dépend du regard… Vers soi règne la solitude désespérante, vers l’autre s’ouvrent les portes de la vie. Une femme se souvient. Son existence est, fut, sera longue. Une femme parle et se conte.
…
La montagne s’est fendue. Feu et lave mêlés. Sang et larmes. Le rouge domine. Il en fut toujours ainsi. Ma mémoire renaît… Comme la lave du volcan… Quel est mon âge ?… Je ne le sais. Je suis née au centre de la terre. Je connus le poids de l’obscurité avant de connaître mon corps… Peut-être était-ce le début du monde. Je ne saurais le dire. Une naissance est toujours le commencement du monde. Je fus avide de lumière avant d’ouvrir les yeux. Le désir, souvent, naît de l’absence.
La lave fut mon berceau et me servit de mère. De son corps arrachées je fabriquais deux ailes. Ailes de flamme, route de lumière. La lumière, déjà, accompagnait mes pas.
Ciel et nuages, terre et eau, la lumière m’accompagne toujours. Ce qui est mon présent fut aussi le passé. Le temps est toujours immobile pour qui sculpte la terre. Et toujours la montagne s’offre à l’homme, s’ouvre pour le nourrir, s’ouvre pour l’engloutir. Ainsi agit la femme, la porteuse d’enfants. Le verger fécond qui s’ouvre à la souffrance comme s’ouvrent les portes d’un refuge. Jamais la révolte ne vint rompre les liens m’attachant au monde. Je n’ai jamais su ce qu’était le désespoir. Les porteuses de vie ne peuvent choisir le doute.
Jaune et verte, profonde et douce, la forêt est mon héritage. Chaque arbre porte les traces de ma sueur, chaque feuille est une sœur, chaque fruit est de ma descendance. Le feu, parfois, de la forêt fut le bourreau. L’homme souvent portait la flamme. Mais la forêt est toujours là et je me trouve à ses côtés.
…
Gris et blanc, rouge et vert, jardin de pierres portant la marque de l’homme, la ville est nue dans mon souvenir. Je fus parmi les bâtisseurs, taillant la pierre, sculptant le verre. Mon corps fut ce jardin, mon cœur sut le nourrir. La lumière, toujours, renaît et contemple la montagne, ce ventre ouvert sur l’infini.
Silence d’un soir d’été.
Cliquetis d’insectes ivres
– par intermittence –
Chamaillis d’oiseaux retardataires
– peut-être le sont-ils
(en retard)
ailleurs que dans mon rêve –
La rumeur s’est tue.
Me dirais-je solitaire ? Les oiseaux sont là. La vie est là. Mon silence est présent. La trame de mes jours s’éclaircit. À la lisière du front recule la forêt. Le corps, ce grand vaisseau de chair, tangue dans le vent des jours. Le granit des os se fait argile mais pas encore. L’esprit ne dort pas…
Mais voici le sommeil au loin. Avant la nuit, murmure une voix, il me faudra tisser la lumière des jours à venir. Un grain de sable construit la route pour d’autres grains de sable. Un soupir s’ajoute aux soupirs et emplit l’espace. Me faudra-t-il longtemps marcher pour que mes pas rencontrent leur ombre ?
Bruits de vagues dans un jardin en feu. Bruissements d’ailes qui surprendraient l’ornithologue (cet observateur de la gent ailée)
…
Il n’y a point d’océan dans la muraille bleutée de mon horizon. Aucun oiseau ne trouble la nudité de mon espace aérien. L’esprit a des libertés que ne connaît pas la matière. Il existe en nous, au-delà des sens admis, des antennes défiant la logique. L’homme ne serait pas s’il n’était que chair. Et l’univers, sans doute, chante en nous par delà notre conscience.
Je suis le vent qui coule.
Je suis le chant du soleil.
L’écho des tourments de la terre.
Ma voix est légion.
Avez-vous prêté, ne fusse qu’une fois, attention aux feuilles d’un arbre ? Le regard se perd à trop vouloir prendre. Il y a plus de vie sur terre que nous ne le voulons croire. L’immensité est terreur pour qui refuse l’amour. Il serait facile de se laisser prendre… Mais la souffrance est habitude trop douce. Qui craint de ne point vivre refuse de s’en défaire.
Je suis le vent serein venu de nulle part. Je suis le vide qui anime la chair. Un soleil, chaque jour, disparaît… Et je suis toujours là. Le murmure d’une goutte d’eau, tombant dans une vasque, suffit à m’abreuver. Le partage donne la vie.
…
Le froid, la nuit, le silence à l’état pur. Le ciel comme une invitation au rêve. Champ d’étoiles. Campus stellae. La vieille route des marchands. Chercheurs d’épices, chercheurs d’âme, chercheurs d’espérance. Je ne sais pourquoi, le froid et la nuit furent toujours mêlés dans mes rêveries. J’aime cette sensation, la solitude, qui pénètre mon corps. La solitude devenue matière. Le mot dépasse le sens, le mot dépasse l’objet. Le mot est un univers transportable et invisible, il est une présence, un réconfort, comme une forteresse face au monde.
Le froid, le silence, la nuit. Le froid, le silence glacé, hurlement des loups, le danger est un voyage. Réalité et rêve réunis, comme deux amants, Isis et Osiris, frère et sœur amants sans être incestueux. Le silence, l’espace blanc, immaculé. Un silence différent, la tache apparaît. Le premier espace n’était pas aussi blanc qu’il le parut de prime abord. Le silence n’est pas une absence, bien au contraire. Il n’y a pas de vide, juste une présence plus ou moins grande de la clarté.
La nuit, le calme et le repos. Je me souviens de ces êtres rencontrés, passé minuit, le temps de l’horloge laissait place à celui de la parole échangée, portée par la respiration. La nuit est échange charnel, quand bien même cet échange serait immatériel. À moins que l’absence de la matière ne soit la condition, unique autant qu’indispensable, de la communication. Je ne sais… La vérité ne saurait être révélée mais seulement perçue.
…
Entre ciel et sable une tour se dresse, liant ces deux infinis. À ses pieds, une foule, hommes ou fourmis, qu’importe… Au regard de l’infini toutes les foules sont identiques. Une tour, pyramide éphémère, monument ? Sans nul doute, mais d’orgueil naïf… L’humilité seule est réaliste. Le sol, notre humus d’origine, ne saurait apparaître sans l’aide orgueilleuse de notre curiosité. Une tour hante ma nuit. L’humanité entière, entassée, chemine vers le sommet.
Fourmi, ma sœur, je ne voulais pas t’écraser ! Et pourtant… Je suis dans la nuit comme un aveugle. Pourtant mes yeux vivent, mais je ne sais pas regarder, nulle honte ni plaisir dépravé, simplement une constatation.
Dans cette tour j’imagine, entassés, des hommes qui festoient. De fête, ici, il ne saurait être question. Je fus souvent frappé par le contresens contenu dans ces mots, la fête, me semble-t-il, est liée à la joie. Joie partagée mais non collective. La masse étouffe les sens et les sentiments. Le festin me semble œuvre du collectif, rituel blafard et guindé, étouffé de l’intérieur. Du festin, la masse est énorme mais nulle la densité. Festin triste dans une tour dont approche la fin. La tristesse me semble inséparable du festin. L’association de ces deux mots serait inutile s’il n’y avait les festoyeurs. Animaux tristes perdus dans l’immensité de leurs solitudes associées. La nourriture est un lien entre ces êtres. Le seul, comme ce grain de riz que porte – supporte – une colonne de fourmis. L’individu n’est rien, réduit au lien unissant la foule. Colonne, foule, communauté… Géante rouge vide de toute substance.
…
En ces époques nues où la chair de l’émotion laisse transparaître le squelette de la raison sociale (raison de l’entreprise individuelle qui, pourtant, méconnaît l’individu), la masse – toujours elle – prend le pas sur l’être… Comme le paraître sur l’existant.
En ces époques nues la politique du reste a rang de philosophie. L’art, quant à lui, ne saurait exister. Un grain de riz perdu sur le pavé devient marbre à sculpter. Un univers voit le jour. Création éphémère d’un amuseur affairé en quête de gains faciles à obtenir. Ainsi commerce et art se confondent. La masse, toujours, étouffe le sens.
Le riz est un paysage. Femmes courbées dans les rizières. Conversations de fin de soirée où la chaleur de l’alcool remplace l’inspiration. Repas partagés, un grain de riz divisé en cinq, puisqu’il y a quatre convives, la cinquième part sera pour le pauvre de passage, le plus pauvre d’entre nous, le rat, ce mal aimé. Ainsi devrait être l’amour, un don, sans rien attendre, à celui qui ne possède rien, pas même l’amour. Du festin à la cène, parfois, suffit un pas, qui sera ou non franchi. Un soupçon d’intention peut changer le monde. Nous étions insouciants, égoïstes, peut-être… Nous voilà acteurs d’un drame planétaire. D’une aile de papillon dépend le sort du monde. Il suffit parfois d’un souffle pour que tombe dans l’oubli une civilisation hier triomphante.
…
Sur une table, les restes d’un repas. Un grain de raisin rescapé d’un génocide. La naissance du vin ne provient-elle pas d’une mise à mort, celle du raisin ? Quelques bouteilles renversées dressent le décor. Cadavres qui furent froids avant même de mourir. Un nom unique désigne la dépouille de l’homme et celle du vin. Les deux dépouilles, souvent, se confondent. Traces de vies perdues.
Des cris, quelques rires. Le sang qui coule dans les veines. Un repas partagé. Des paroles échangées. Puis la mort, qu’il y eut ou non un bûcher. Seule reste la cendre.
Un jour, le silence, pas l’absence de bruit, non le vide, mais son contraire. Le silence est là. Présent comme du granit. Des ondes, vibrations incertaines, souterraines, intériorisées. Un tremblement à peine perceptible s’empare des corps. Perçue tout d’abord comme un fantasme, sa réalité, bientôt, ne prête plus au doute ce qui appartient à la peur. Peur du cataclysme. Du tremblement de terre, cette mort offerte par la nature. La tour s’écroule. Le désert reprend ses droits. Un grain de raisin encore vert est tombé (d’une table sans doute) La table n’est plus, reste son ombre, fruit trop vert pour être convoité.
…
La solitude reste ma compagne…
Nous ne sommes jamais seuls. Le sable, ce sang de la terre. Les pierres, qui en sont le squelette. La lave, cette chair brûlante, ce corps incandescent, ce fleuve de lumière, orgie de souffrance. La beauté méconnaît la compassion. L’argile liquide née de l’eau visitant la pierre. La vision d’une eau boueuse, souvent, rajeunit mon souvenir des liquescences, ces neumes ornementaux de la musique médiévale.
Neumes : signes, images stylisées, d’une pensée mélodique, qui serait d’abord pensée avant d’être mélodie. En ces temps de clairvoyance, sur ce point précis, le temps s’effaçait devant le mouvement. Précision et communication, précision dans la communication.
Le mot est un signe trompeur (parfois)
Précision et communication. La pensée de l’essentiel devient image. L’image rutilante de ce que doit être l’essentiel vital pour une société du superflu éphémère. Je songe souvent à une civilisation du baroque. Non point le baroque pensé comme une apparence, comme l’image – encore elle – d’un monde sans aspérités, d’un univers qui ne connaîtrait la vie ; mais comme une civilisation connaissant et pratiquant la science de l’ornement.
…
Des formes provient la vie, non des structures. Je rêve d’un monde où les codes se feraient modestes, simples bornes sur nos chemins communautaires. Signaux plus que signes, pense-bêtes ne nous prenant pas pour des imbéciles. L’homme façonne le monde à son image. Mais l’image est trompeuse, j’espère.
J’aurais la nostalgie de la pierre si j’étais nostalgique. Mais je ne le veux point. S’agit-il vraiment d’une volonté ? Pouvons-nous être autrement que ce que nous sommes ? La Pierre, la source, le brasier, le vent, voici mes quatre éléments, mes racines mythiques, mon squelette du dehors. La pierre, non la terre. La pierre vécue comme un bloc, entité inaltérable et indestructible. La pierre, planète-mère, telles ces déesses antiques portant, aux yeux de l’homme, la responsabilité de sa création. La pierre, bien entendu, ne saurait à mes yeux supporter le poids de nos égarements. La pierre n’est pas humaine… Ici, donc, pas de sentiments : la cruauté et la tendresse ne sauraient avoir de sens.
La vie dans son essence la plus pure jaillit. Comme une source liquide, solide ou éthérée. L’eau, bien sûr, le jaillissement d’une cascade, qui d’ailleurs, peut être cascade en réduction. La goutte d’eau s’échappant du robinet. Ou bien encore le filet d’eau coulant entre deux pierres. L’idée, ici encore, déborde du signe.
…
La cascade fut toujours, en mon esprit, porteuse d’un sens multiple, au-delà du désir sublimé ou bien d’une pureté qui n’a, me semble-t-il, de réalité autre que théorique… Le sens n’est pas le mot, moins encore le signe, et ne saurait être réduit à une définition, explication mercantile pour guide touristique. De la cascade au fleuve, cette rivière pour géants, l’imagination demeure notre troisième œil, et de cet œil jaillit la source de la vie.
Le fleuve est un torrent qui aurait pris des habitudes. Comme moi sans doute. Pourtant je ne me sens pas fleuve. Ruisseau peut-être, caché dans les sous-bois. L’expression de la puissance n’est pas de mes désirs. Les fleuves, même les plus indisciplinés, respectent l’ordre extérieur. Le ruisseau suit son chemin sans se préoccuper de l’ordre du monde. Il possède sa propre organisation et n’en est pas possédé. Il est l’ordre, le vrai, celui exempt de structures, sans cesse changeant, toujours exact.
La vanité est sans doute un défaut.
Le torrent, de principe aquatique, est pourtant l’essence même du brasier. Le jaillissement multiple de la source, origine du torrent, est infiniment plus proche de l’image solaire que ne peut l’être le feu.
…
La terre, l’eau, l’air, le feu… Ces symboles élémentaires sont signes plutôt qu’entités fondamentales. La pierre, le brasier ou la source, ainsi que le vent, sont entités charnelles avant d’être signes. Quatre univers remplacent les éléments. L’un d’entre, le vent, des trois autres se compose. La pierre est sa chair, le brasier est son cœur, la source son sang… L’air ne saurait contenir le vent, qui est matière et esprit, voix multiple et solitude, l’infini rejoignant l’absence.
Le vent ne s’explique pas. Le vent ne se peut conquérir. Le vent ne saurait être maître ou esclave.
Ce que chante le vent aux arbres, comme s’ils étaient encore des arbrisseaux fragiles à peine perceptibles pour l’œil indifférent, ne saurait être entendu par l’ambitieux cherchant à gravir un à un, et si possible en compagnie de cette souffrance rédemptrice qui, accompagne, au dire de certains, l’apprentissage laborieux du savoir respectable.
Ce que chante le vent aux arbres, ainsi qu’aux enfants, ces arbrisseaux à la tendre chair, n’appartient pas au monde de la raison, cette donneuse de leçons austères et stériles. Ce que chante le vent aux arbres ne saurait trouver grâce, s’il la demandait, auprès d’aucun censeur, ces respectables empêcheurs d’exister.
…
Il y avait un arbre, jeune encore – bien que ses feuilles l’eussent abandonné, déjà, lors de plusieurs automnes – qui vivait heureux sur une colline. Il vivait son existence d’arbre qui est, comme l’on sait, différente de la notre, de part sa longévité autant que par son mode de déplacement, immobile en apparence et vertical. L’arbre ne connaît pas l’agitation de l’homme qui, bien souvent, bouge sans avancer. L’arbre tend à l’élévation et non à cette forme d’ivresse qu’est souvent le voyage humain.
L’arbre, donc, vivait… Paisible, peut-être, serein sûrement. Il ne vivait pas sur sa colline. Il ne vivait pas avec sa colline… Il était la colline. Et, de la même façon, la colline était l’arbre. Il était aussi l’oiseau, venant quelques fois se poser sur ses branches, ainsi que le rongeur qui passait… Ou bien même le scorpion… L’arbre ne connaissait ni le mal ni le bien.
Lorsque je dis de l’arbre qu’il vivait heureux sur sa colline je tiens un raisonnement d’humain. L’arbre, bien entendu, n’aurait jamais eu une telle pensée. Nous découpons notre vie en tranches. Les instants de bonheur suivent les instants de déplaisir (le malheur est une notion trop forte pour être découpée) Les arbres ne séparent pas les instants, ils vivent du rythme de la nature, ne connaissent pas les sentiments humains, cette division de l’âme.
…
L’arbre sur la colline était l’univers. Il était la terre. Il était le feu. Il était l’eau et le nuage. Il était la matière et l’énergie…
Mais il n’était pas le vent. Le vent fait partie de l’univers, mais il n’est pas seulement énergie et matière, il est aussi pensée. Non point pensée particulière, ni même pensée abstraite et absolue, mais la pensée originelle, dans sa plénitude.
Le vent ne soufflait pas pour le plaisir. Il ne soufflait pas non plus par nécessité biologique, il était avant tout un chanteur. Il vint sur la colline, étendit son souffle comme un oiseau tendrait ses ailes au moment de l’envol. Il pénétra l’arbre et se mit à chanter. Je ne pourrais vous dire ce que fut ce chant. Je n’en connais point la signification mais l’arbre en saisit le sens. La compréhension eut-elle une place dans cette rencontre ? Je l’ignore. Mais ce jour vit le commencement de la métamorphose de l’arbre.
Ce que fut ce changement échappe à ma compréhension.
Un arbre presque mort, de vieillesse, sans doute. Quelques grains de sable ou d’autre chose. Un oiseau que guette un chat. Un bruit de vague imaginé. L’aboiement d’un chien au loin. Une rencontre furtive – bruits de voix, presque un murmure – Au milieu d’un parc, une maison neuve sort de terre. La naissance d’une pierre est un événement.
2
Je suis la source, le feu souterrain.
Je suis la rumeur qui monte.
Je suis la pierre de lune.
Je suis le volcan éveillé.
Je suis le tremblement de la terre,
le vagissement du nouveau-né,
La plainte du vent qui meurt.
Je suis ma solitude.
J’entends le bruit des vagues, comme un cri silencieux, tempête sous un crâne, crâne d’œuf, dit-on parfois… J’imagine un œuf porté au rouge qui explose… Parfois s’imposent des images sans signification apparente. Je vois un homme en route vers l’enfer. Il entre, hurle plus qu’il ne parle. Les mots sortent, comme arrachés à sa souffrance. La faim, la peur, la solitude… Tristes compagnes. Peut-être a-t-il oublié la tendresse, la sienne comme celle des autres. Il ne doit plus savoir rire, moins encore sourire. Le rire, encore, doit lui être possible, mais comme une déchirure. Le sourire, cette lumière de l’esprit, n’est plus qu’un fantasme. Il se sait humain mais il est seul, alors, à quoi bon… Mais il ne veut pas mourir, pas comme çà !… Pas encore… Et pourtant !… Personne n’accorde de prix à son existence. Il pourrait crever, laisser sa vie se répandre sur le sol comme une eau salie, usée, terne de toutes les pollutions. Il pourrait s’oublier sur le trottoir, laisser son corps épouser les formes incertaines de cette rue pavée à demi. Pendant ce temps, ce qui lui reste de vie rejoindra le néant.
…
C’était la grande peur de son enfance : le néant, le vide…
Aujourd’hui, au regard du vide de son existence, la mort lui semble une douce plaisanterie. Il va mourir, c’est sûr, mais pas tout de suite, pas comme çà. Ce serait un nouvel échec. Rien de nouveau, à vrai dire, sa vie fut une suite d’échecs… Mais justement, ce serait si bon de connaître – ne serait-ce qu’une fois – un semblant de réussite.
Mourir ?, bien entendu, mais le ventre plein, la panse reconnaissante… Pourtant, il ne fut jamais un gros mangeur… Non par goût, moins encore pour la ligne… Mais par peur, la peur des moqueries, celle d’être en retard, la peur d’en faire trop, de se faire remarquer… Tout cela, c’était au début. Très vite, il n’eut plus besoin d’avoir peur pour ne pas manger. Il n’avait plus le choix. C’était toujours une peur qui disparaissait. Le choix, le risque de se tromper. Prendre la mauvaise rue, la mauvaise décision, se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.
Il se souvient d’avoir possédé un dictionnaire. Posséder ! Le mot est curieux… Surtout pour lui qui ne possède rien. Ce mot résonne étrangement dans son esprit, associé à ce livre qui fut, pour lui, le seul. Il ne s’en sentait pas maître, bien au contraire… Tous ces mots alignés, ces images qui défilaient… Et qu’il oubliait, la plupart du temps, une fois l’ouvrage refermé.
…
Un seul mot, lui semble-t-il, est resté gravé dans sa mémoire : chance… Un mot magique. Un mot pour enfants sages. Un mot pour s’endormir le cœur au chaud. Comme ces contes de fées qui ne peuvent exister, mais justement, c’est ce qui les rend beaux.
Oh, il n’a pas à se plaindre. Et puis, de toute façon, à quoi bon ? L’important, c’est ce qu’il va faire maintenant.
Il marche droit devant lui. Il sait qu’il ne peut se tromper, il a compris ses erreurs passées. Avant, il voulait se fondre dans la masse. Pour échapper au destin (Dieu, lui semblait-il) Et puis, il n’a plus cru. Aussi s’est-il laissé porter par la foule. Aujourd’hui, il sait. Dieu est un cyclope et son nom est chance. Alors il marche. Droit devant lui. Droit vers l’œil.
J’entends un bourdonnement m’envahir. Un son peut-il avoir une présence ? Un son peut-il être autre chose que signe, perturbation de l’atmosphère ? Sommes-nous autre chose que vide se déplaçant dans le temps ? Peut-être sommes-nous seulement les chiffres de l’horloge cosmique. Presque rien au regard de l’infini. L’homme est peut-être une erreur, un piège à lumière sans signification…
Le sang se révolte lassé de ma vie. Simple interprétation : si je n’étais le sujet de mes propres observations, que serais-je ? Un « à quoi bon » porteur de masque ? Qui sait ?
…
Je vais mourir. Le cœur éclatera. Peut-être par accident… Le cerveau, je l’espère, me restera fidèle jusqu’à la fin. Ce serait trop triste si n’existait la pensée, la possibilité de volition, l’accès au choix subjectif… Mais peut-être n’existons-nous que dans l’action, comme des légumes qui poussent.
Je ne connais pas mon avenir. J’ignore le cours de mes pensées futures. Je peux rêver, faire des projets, dresser des plans. Ce ne sont qu’écume sur l’océan.
Seul est clair le passé, ce poids inutile de la mémoire. Je me sens vieux parfois. Est-ce la charge des ans, celle de la douleur ?
Le chagrin des autres est une souffrance. Nos peines sont un moteur. Pourquoi la peur, la haine, le désespoir ? Il m’arrive de me sentir seul, fermé au monde. Peut-être suis-je un autiste virtuel… Je vais mourir sans t’avoir revue. Il me semble, parfois, entendre s’effriter ton squelette. Le néant serait-il notre seule espérance ? Tout ne peut être vain ! La solitude n’est pas la malédiction de l’homme. Notre existence ne peut être le fruit du hasard.
La vie est une machine dont nous sommes les rouages.
…
Comme tout le monde j’ai peur. Peur de vieillir, peur de mourir, peur d’avoir peur… Et surtout peur de ma capacité à être heureux. Peur de l’amour, peur de ma tendresse… Peur de ne pas être à la hauteur de cet amour…
Nous avons toujours peur de la lumière. Le brasier nous semble un gouffre, l’enfer en quelque sorte, alors qu’il s’agit d’une source !…
Il ne faudrait jamais être sérieux, l’important se trouve dans le jeu. Jeu avec les mots, jeu avec les sens, jeu avec les idées…
Jeu avec le vide. Le précipice est notre seul garde-fou. J’aime une salamandre à visage de femme. Son corps est un brasier, son regard ma source… Un regard vert. l’arbre, toujours, m’obsède.
Une flamme, chevelure au vent.
Un ruisseau au loin, naissance de la parole.
Un corps ébloui par sa propre existence.
Une goutte de sang à la lisière des lèvres.
Une larme, aussi, signe de printemps.
…
La nuit encore. Une étoile ce réveil, contrepoint au silence, la lumière des cieux. Comme une fugue. J’aime cette idée. Non point seulement en musique. La fugue, la chasse, la fuite, le ricercare, cette recherche non de formes mais d’intentions. Les sons et les formes peuvent disparaître. Reste la musique, restent les étoiles. De l’humus au cosmos une onde est déployée. Je me détache de plus en plus du signe. Seules comptent les prémices. La Voie lactée était-elle une route ?…
J’aime les ruines qui préservent la beauté. J’imagine une ville détruite, par un tremblement de terre sans doute, seules demeurent les fondations, comme un plan – non de ce qui fut mais de ce qui sera –
Les chefs-d’œuvre, souvent, n’auraient nul besoin d’être achevés. L’impulsion est là. Il est des romans qui ne furent jamais terminés, l’auteur pourtant n’était pas mort. Pourquoi s’est-il arrêté en chemin ? L’imaginaire est notre patrimoine, le seul, peut-être.
J’aime une salamandre au visage de femme. Le feu et l’argile la hantent. Esprit d’enfant qui ne saurait grandir, ou bien d’adolescente refusant de vieillir. Ici apparaissent les deux termes de notre malédiction : Apprendre la joie c’est approcher la mort.
J’aime donc une morte en sursis qui refuse de vivre parce qu’elle fuit sa destinée. Mais elle partira quand même !
…
Nos amours intimes ne peuvent être qu’éphémères. Je suis fait de poussière et retournerai à la matière.
L’image est étrange, si l’on y pense, les cheveux d’abord, les muscles ensuite… Un jour, sans doute, les cellules cérébrales me quitteront. Je ne peux me penser sans mémoire, et pourtant, que restera-t-il de moi lorsque la chair m’aura quitté ? La matière se situe-t-elle au-delà de la chair ? Existe-t-il un dieu ? J’en serai surpris, ne croyant qu’au vent comme ultime avatar de la vie.
Le souffle du vent sur la surface d’un lac. Miroir déformé. L’image devient une présence. Présence gigogne, comme ces poupées emboîtées l’une dans l’autre.
Ma présence, d’abord, pénétrée par le vent, par sa présence. Le lac enfin… Le vent, bien sûr, ne conserve pas son intégrité. Son image est portée par mon regard qui le déforme. Je suis dans l’image du vent. Je me trouve aussi dans la présence du lac. La réalité est un mystère, la nature est complexe. La vie ne se peut saisir d’un regard analytique. Le sens est tout, signes cachés à découvrir, voies souterraines, enfouies. L’important n’est pas seulement de trouver. La recherche est une ascèse. L’art n’est pas loin. Art du long terme exigeant un travail long et douloureux, comme on le dit d’une maladie ou d’une quête. Il convient de procéder par tâtonnements furtifs. La réalité est une caverne qui ne se peut ouvrir que tendrement.
…
Aimer une salamandre (humaine) est un choix d’existence. Choisir c’est toujours prendre une route. Celle-ci est la voie obscure qui méconnaît la facilité. Aimer, c’est écouter, ressentir, comprendre, se laisser pénétrer par l’autre. Aimer c’est laisser vibrer le chant de l’autre dans nos cellules, c’est donner à l’autre la clef de notre mémoire. Aimer l’autre c’est se rencontrer. Alors vient la peur, alors vient le doute : serai-je à la hauteur ? Non, bien sûr, nous ne le sommes jamais (ou toujours, ce qui revient au même)
Il est des fragments d’étoiles dans chacune de nos amours. Diamants brisés, émiettés plutôt, comme ce pain offert aux oiseaux de passage et préparé d’une main attentive par ce vieil homme qui, chaque jour, vient s’asseoir – à la même place, toujours – dans ce square où, enfant, il venait jouer. Cinquante années ont fui. Les gestes ne sont plus les mêmes. Seul le parcours reste inchangé.
Sommes-nous autre chose qu’une énergie qui se meut ? Il est des heures dominées par le doute. La vie est-elle autre chose que le passage de l’ombre à la clarté ? Nos jours connaissent-ils la lumière ? Nos nuits vivent-elles ? Le temps passe et nous questionne. La vie n’est plus qu’un fil prêt à se rompre, elle se fait abstraite comme l’ombre d’une illusion…
…
Est-il possible, encore, d’aimer au singulier ?… J’aime une salamandre et mon esprit s’en va à la dérive. Je tente de me raccrocher à la logique, ce sol incertain, mais il ne s’agit que d’un mot. Je me pensai dans la réalité, en alignant mes mots comme le statisticien aligne ses chiffres, mais la vie ne se laisse prendre à aucun filet. J’aurais tout tenté : introspection naturaliste, descente vertigineuse au fond des gouffres de la raison, invocation aux étoiles… Parcours de l’écrivain en herbe à la recherche de l’inspiration.
Inspirer, expirer, tout est une question de souffle… Le vent encore. La caresse de l’esprit. Mais l’heure n’est plus à la douceur. Les corps tombent, exsangues. La violence du jour serait-elle incompatible avec la tendresse d’un soir d’été ? Pensée futile ? Je n’en suis pas sûr ! En fait, je suis même certain du contraire. Ma seule préoccupation est d’avancer. Qu’est devenu l’enfant sans frontières qui jouait à se faire peur comme joue le torrent perdu dans la montagne ? Il est, aujourd’hui, caché au fond de ma raison… Mais je ne me veux pas raisonnable !
Je ne veux point tenir les comptes de ma vie. Comptes d’apothicaire, dit-on, vente ou distribution de petits cachets roses pour s’oublier. Je ne veux pas non plus conter à l’enfant que je fus des histoires à dormir debout. Dans ce cas, que l’on soit allongé ou debout, on est toujours couché. Je n’accepterais pas d’autres contraintes que celles imposées par la vie.
3
Qu’est devenu l’enfant sans frontières qui jouait à se faire peur comme joue le torrent perdu dans la montagne ? Il est, aujourd’hui, caché au fond de ma raison… Mais je ne me veux pas raisonnable !
Suis-je un animal ?… Peut-être. Mais un animal pensant, comme je les aime, sauvages et cruels, parfois, mais jamais endormis, de cette forme de sommeil qui ressemble à la mort. S’ils n’étaient endormis, les moutons ne se laisseraient pas mener vers l’abattoir. Troupeau triste que nul ne souhaite éveiller. Le gladiateur, au cirque, endormait Rome, de l’enfant au vieillard, venu savourer sa souffrance. Lieu de culte et lieu de culture sont bien les deux aspects d’une même nécessité.
Ne pas se réveiller… La vie est un ogre, long couteau et nez de clown. Laissons-nous engraisser et dormons lorsque viendra l’heure du couteau. Oui, eh bien moi, je veux voir le couteau faire son office, parce que c’est çà justement qui est intéressant ! Je veux voir la vie me découper en tranches. Je veux voir mon sang couler. Je veux voir mes plaies se refermer. Je veux voir mes membres repousser comme les branches d’un arbre. Je ne veux pas de rêves, je ne veux pas de spectacle vivant, je veux ma vie. Et pas une vie par procuration. Avec décors et costumes virtuels. Pas une vie écrite sur commande par un vieux scénariste blanchi tel l’argent sale. Pas une vie mise en scène par un penseur au rabais, ministre du temps libre à ses heures perdues, toutes probablement. Et puis, surtout, je ne veux pas être l’interprète d’un vaudeville raté et désuet écrit par un autre que moi. S’il me faut exister, que la faute soit mienne.
…
Pour ceux qui ne le sauraient, l’inexistence est à l’existence ce que l’anti-matière est à la matière. De toute façon, nous voilà aux confins du réel… Nous ne sommes pas plus avancés car, qu’est-ce que la réalité sinon le souffle de la vie passant sur une illusion ?
– Presque rien.
– Dont il ne faudrait parler qu’à mi-voix, par crainte de le voir s’envoler, l’ombre d’une action murmurée.
– Une action peut-elle avoir une ombre ? Cette ombre peut-elle prendre la forme d’un murmure ?
– Pourquoi pas ! Tout est possible dans la vie.
– Ah bon ? Je l’ignorais.
– Bien sûr, puisque vous dormiez !
Si les moutons n’étaient endormis, ils pourraient voir se produire l’impossible.
La vie est un éternel retour.
Jardin de pierres.
Un lac comme un miroir de poche.
Lisse et dur.
Miroir, mon doux miroir…
S’il m’était possible de me voir tel que je suis.
S’il m’était possible d’en faire le vœu.
Qu’elle serait ma décision ?
Une goutte de rosée tombe.
L’œil de la salamandre connaît l’humidité.
La source est partout…
En nous ?
Sans doute…
La vie ne saurait être divisée.
…
Le mot est-il matériau ou bien matière ? La chair de l’émotion n’est pas une simple expression. Il y a la chair : matière en mouvement, ce qu’il ne faudrait pas confondre avec le déplacement.
Deux notions distinctes, donc, mais non abstraites. J’entends : simple abstraction (la notion) mais aussi action (qui se pense et qui pense : qui réfléchit) qui se pense en tant qu’action, qui se conceptualise. Le mouvement, donc, est action (l’acte de bouger) mais acte capable de se conceptualiser… Et de réfléchir, de penser son action… Ainsi que de se voir agir et réfléchir (comme le ferait un miroir).
La chair, donc, est matière pensante. La vie est présente, mais n’est pas l’univers, qui est la vie avec une majuscule. Peu de différence, donc, la vie demeure elle-même.
À voix basse…
Murmures presque musique
– plutôt que confession –
Me revient ce poème
(haché)
Venu du fond d’une mémoire.
Qui fut peut-être mienne.
Chaque heure porte son fardeau
De brume, de peur et de haine.
Je chante la mort de mon ennemi
Et me réjouis de son malheur.
…
Chaque heure porte l’espoir.
Je chante la mort de mon ennemi
Et ma haine devient forteresse.
J’oublierai jusqu’à mon nom.
J’oublierai jusqu’à ma vie.
Chaque heure est une délivrance.
Je prendrai la place de mon ennemi mort
Et hurlerai dans son silence.
Chaque heure est un déchirement.
Je chante mes amis oubliés.
Leurs voix résonnent en mon âme.
Je n’irai plus en solitaire
Le long des gouffres frémissants.
Chaque heure souffre de nos doutes.
Chacune de nos larmes est une rivière,
Une lumière annonçant le printemps.
Chaque heure porte notre amour.
Je suis la vie qui chante l’éternité.
Je sais vos pensées
et mon cœur s’offre à la compassion.
Chaque heure efface nos peurs.
Je regagne le monde des vivants.
Je connais l’amour,
Le poids réel du temps.
…
Chaque souffle invente la vie.
Chaque rêve entrouvre une porte.
Je suis cet amour infini
Dont parlent les annales.
Je suis l’univers
Qui jamais ne se meurt.
J’entends ce chant au loin… Solitaire. J’imagine le corps, privé de lumière sans doute, qui le porte. Je ne sais si la brume est née de la haine ou bien de la peur. La peur est-elle à l’origine de la haine ?…
Les mots ont leur musique. Je peux la percevoir, la recevoir, je peux être touché par elle, mais je ne peux m’identifier à ce qu’ils expriment.
L’espoir et la mort, l’association est étrange. Je ne sais si elle est possible à certains. Je resterai ce que je fus toujours et ne prendrai aucune place qui ne soit mienne. Je me souviens de l’amour reçu, de la joie offerte et de cette tendresse qui souvent me submerge. Aimer est un véhicule au service de l’infini. J’aime les saisons ! Non pas l’une après l’autre mais réunies toutes dans une seule pensée.
La pérennité naît du changement. J’aime une salamandre qui n’a pas encore vu le jour. Je regarde l’arbre bouger, feuilles indépendantes et pourtant liées. Le vent pénètre leur espace plus qu’il ne les touche.
…
J’aimerais passer ma vie à renaître. Je prendrais mon envol à la pique du jour pour disparaître en compagnie de la lumière.
Pourquoi écrire ?
Peut-être est-ce pour voir
La page blanche peu à peu noircir…
Il ne faudrait rien garder.
L’imaginaire devrait toujours rejoindre le néant. Échapper à l’anéantissement (qui n’est pas la mort) je désire pénétrer en toute parcelle de vie longeant ma route. Je veux aller à la rencontre de toutes les formes de joie. Je me souhaite, chaque jour, de plus en plus ouvert à la vie. L’égocentrisme est le seul échec que peut connaître l’homme. Je ne prétends pas abolir mes défaillances, mes défauts… Je veux, simplement, découvrir, mettre à découvert, la part de vie contenue dans ces parcelles d’ombre.
Bourreaux ou victimes, nous sommes tous des assassins. Nous tuons chaque jour, sans le savoir, un peu d’amour, une parcelle de joie, une part de vie… Ainsi sommes-nous conçus. Nous fuyons l’enfant innocent qui est notre géniteur, pour nous transformer en machines à fantasmes, en pièges à douleurs. Le goût de la culpabilité est notre perversion extrême. Je veux réapprendre à rire. Je veux, de nouveau, connaître le parfum des bonheurs simples. Je veux te trouver, qui que tu sois, où que tu sois, ma salamandre inconnue, mon Prométhée affamé (de et par l’amour)
4
Quelques pierres répandues.
Un ruisseau qui s’éveille.
Deux ou trois montagnes
– dans le lointain –
gros rochers oubliés
(par un géant de passage)
Le monde est petit
pour qui le regarde d’un sommet.
5
La nuit approche. Serais-je en retard à son rendez-vous ? Qui est-elle ? Personne, élément ou bien… L’enfant au berceau est plus savant que moi. J’aimerais être vide encore, attendant d’être rempli, peu à peu, tel un flacon. Tout serait simple alors ! Mais je suis homme, de pensées et de chair, à moins qu’il ne s’agisse de chair et de fantasmes…
Puis-je conduire ma vie ? Puis-je exister de (et en) moi-même ? Je me voudrais insensible à tout ce qui n’est pas la beauté, mais je suis homme. De chair et de sang, bien sûr, mais aussi plus profondément… M’est-il possible de parler d’âme ? L’être religieux, que je ne suis pas, le pourrait. Qu’en est-il pour moi ?
Je sais, parce que mon corps et mon esprit le savent et le sentent, qu’il existe, par delà la matière, une force inexpliquée à ce jour. L’univers est vaste et ne livre ses secrets qu’au prix d’une longue patience. Le monde existera bien après mon départ. Que deviendrait l’espérance s’il devait en être autrement ?
J’imagine la terre à l’aube d’un nouveau jour. L’homme n’est plus ce qu’il est aujourd’hui, mais la race n’est pas éteinte, seulement transformée. Quelques millénaires ont passé. L’univers continue son voyage, dans le temps ou l’espace (je ne sais) Regardée de la perspective des dieux, ce humains transcendés, la galaxie tient du jardin japonais.
…
Un soleil, fleur de tournesol.
Quelques rochers en place de planètes.
Une feuille tombe d’un arbre,
météorite de passage.
Un enfant qui dort.
L’humanité prépare son envol.
Le feu affirme sa présence. Notre soleil n’est pas encore mort. Le brasier, toujours, renaît du fond de ses cendres. La terre se meurt en surface, elle continue par-dessous son activité expansive. La source s’est tue, sans doute est-ce pour mieux écouter. Flammes et poussière, les arbres sont en deuil, bientôt le vent annoncera la vie.
Je me souviens d’un matin qui me parut unique. Le monde était plus jeune. J’étais déjà vivant. Combien de vies l’homme peut-il parcourir ? La réponse n’est pas importante, nous apprenons à mourir, l’apprentissage de la vie demeure notre lacune.
J’aime une femme qui fut une salamandre. L’alchimie, toujours, tient ses promesses. J’aime, mais suis-je aimé ?…
Quelle importance ! Ce qui fait partie de ma vie ne peut m’être pris. Je ne pourrais le donner même si je le voulais.
Mais je peux offrir ma joie.
La vie se remplit de ces petits bonheurs.
…
Le silence est une source où il me faut boire. Une blanche page qui ne deviendrait jamais noire. Le sens ainsi demeure évident. Le sens, toujours, sera ma préoccupation.
La communication avec les anges ? Le silence serait-il un gouffre ?
Trou noir… Antimatière… Spirale, piège à vertige. Peut-être faut-il perdre le goût du bonheur pour trouver le sens de notre existence.
La vie est-elle porteuse d’une signification précise ? Les anges ont-ils des ailes ? Je ne sais… Ils ont certainement un sexe, le contraire me décevrait…
Je ne peux supporter l’idée de l’angelot rosâtre, le ventre lisse, la poitrine plate, et les fesses gonflées plutôt que charnues. Je ne veux non plus imaginer un ange velu, l’image m’est trop pénible, plus proche du rapace grabataire et poussif que de l’humain ailé. L’ange ne peut qu’être femme, l’avenir de ma foi est à ce prix.
…
Jardin de pierres… Ce lieu vit mon berceau, connaîtra-t-il mon tombeau ? La vie est une spirale et le temps est une route. Je rêve d’écrevisses rougies par la cuisson. La musique en moi sera toujours présente. Machaut, Bach, Varèse et quelques autres, cailloux en archipel, délimitent mon royaume. L’esprit s’oublie dans cette immensité. Des arbres stylisés, branches plutôt que troncs, tissent ma mémoire. Le souffle du vent discret ignore la tempête.
Ma fin sera mon commencement.
…
Je marche sur mes traces anciennes. Je ne serai jamais un bon guide. Ma voie m’apparait plus incertaine que ma voix… J’ai toujours eu du mal à m’exprimer. Je m’imagine, non sans mal, télépathe et ne suis pas sûr d’aimer cette idée. L’absence du corps, sonore ou charnel, présente autant d’inconvénients que d’avantages. J’imagine la situation :
Petite tragi-comédie inspirée d’une pantomime à l’antique manière.
Arlequin, debout, sur le devant de la scène, dans ce costume cher aux enfants sages et érudites (l’opinion des hommes ne me préoccupe pas) face à lui, colombine, dans le même costume. Ils se parlent. Aucun son n’est émis. Leurs figures sont identiques. Simples images théoriques, comme leurs noms : À et C pourraient remplacer Arlequin et Colombine, A et B serait plus logique, A et A plus proche de la réalité.
Un homme voit son reflet dans une fenêtre sans vitre. L’imagination est au travail, me direz-vous, à moins qu’il ne s’agisse de la mémoire. Cet homme est amnésique. Il sut compter sur ses dix doigts avant qu’un accident ne le prive de ses membres supérieurs et inférieurs ainsi, d’ailleurs, que du reste de sa personne. Malgré tout, le reflet est réel. Pour l’homme tout au moins. La nature est miséricordieuse.
…
La mer danse pour la lune. Mes ancêtres furent des insulaires. Le mot Iliens fut ma pensée première. Je suis né au milieu de l’eau. Sa douceur, souvent, me hante. Eau et roc furent mes premières amours. Le bois et le feu vinrent ensuite. Aujourd’hui, le vent est ma passion.
Je me voudrais homme au manteau de vent… Serais-je obsédé par Eole ? Je ne me veux pas incarnation du vent. Je ne l’ai jamais regretté. Telle est, peut-être, l’une de mes faiblesses. Qu’importe… Je suis enfant d’une civilisation et ne le nie point. J’aime le vent comme on aime un ami intime. Sa nature, différente de la mienne, le rend plus aimable encore, plus aimé surtout. Le vent est le souffle de la vie fécondant la terre. Comme un feu qui oublierait de mordre. Comme une source d’eau fraîche presque désincarnée. Le vent est la mémoire du monde.
Quelques arbres endormis. Un souffle léger, presque improbable. Une fleur oubliée qui se meurt. Le regard chavire, emporté par la nuit. La ville se fait douce mais ne se peut oublier. Son silence est sale, comme honteux. La ville, toujours, reste présente. Bruits vides de sens, inertes, bruits presque cadavériques. L’odeur, sans doute, est trompeuse. Le vent me manque ainsi que la montagne. Je me souviens. Deux êtres, solitaires et complices. Le vent fut un témoin discret.
…
6
Maya : une falaise abrupte. Une cascade en chute libre. Deux ou trois rochers fracassés. Une pluie fine et dure qui s’arrête. La douceur provient du regard. Un parfum de terre humide me submerge. Il serait pourtant imperceptible à qui n’est pas sensible aux chants de l’herbe humide. Le silence est gris, presque blanc. Comme une neige qu’entacheraient quelques bruits furtifs… Que fais-tu ?
Icare : presque rien, je contemple le néant. Il ne faut pas en avoir peur. Les fleuves aussi furent des gouffres avant que l’eau ne les emplisse… La vie, toujours, reprend ses traces. Elle se renouvelle pourtant à chaque fois et jamais son inspiration n’est prise en défaut.
Maya : L’eau est ma sauvegarde. Surtout lorsqu’elle court, libre, dans les montagnes. Le ciel s’éclaircit, bientôt reviendra le soleil. Le souvenir demeure, raffraichissant, maintenant le silence est blanc. Sans doute s’est-il vidé de sa substance ?
Icare : Je suis au bord du précipice, il y a un arbre ancien. Ses racines mordent la roche… Au fond du gouffre coule une rivière… L’arbre plongera-t-il pour la retrouver ?…
Maya : Je n’aime pas rester sans bouger. J’ai besoin de prendre possession de l’espace, de m’intégrer aux formes que j’aime, de les désirer. J’aime sentir la vie, dans chaque pierre au bord du chemin, chaque brindille qui s’envole, chaque souffle sur ma nuque.
…
Icare : le néant, parfois, me questionne. Il sait être un interlocuteur patient et attentif. Vieux complice cultivant l’ambiguïté jusque dans les confrontations les plus intimes, les plus amicales. Est-il ami ou bien adversaire assidu ?…
Maya : sa fidélité, en tout cas, ne saurait être remise en question !…
Icare : ainsi est le néant !, fidèle jusqu’à la goujaterie ! Je peux sentir sa présence dans chacune de mes cellules, chacune de mes pensées.
Maya : tu réfléchis trop.
Icare : je me voudrais simple. La simplicité du volcan comme celle du lièvre qui ne se regardent pas agir.
Maya : le vent, créant la tempête, n’éprouve ni honte ni fierté. Le fauve tue sans arrière-pensée.
Icare : l’homme seul se rappelle. Il sait sa propre mort et rencontre le vide. Le néant est parole muette, insidieuse et la mort l’accompagne. De là provient ma peur. Une peur irraisonnée qui me submerge. Tel un défi à la logique, une aberration incongrue poussée à l’intérieur d’un système de pensée cartésien.
Maya : tu finiras par te perdre.
Icare : si je le pouvais, je ne penserais pas. Je serais rivière connaissant son but sans jamais l’avoir appris. Je me coulerais dans mes traces anciennes…
…
Maya : tu chanterais avec l’oiseau… Tu chanterais comme l’oiseau… Simplement. Parce que la vie existe… La chaleur d’une fin d’après-midi t’enivrerait… L’arbre serait ton refuge et ton compagnon… L’insecte te nourrirait. De sa chair… De ses chants…
Icare : de son silence…
Maya : de sa présence…
Icare : mais je ne suis que questions en suspens !… Comme un équilibriste pris de vertige.
Maya : épris du vertige ! Cinq cents mètre plus bas : la roche… Au loin… La vie de tous les jours.
Icare : derrière moi la solitude. Devant se trouve la liberté… Une liberté passagère.
Maya : bien sûr !
Icare : comme une friandise fondant au soleil…
Maya : le but n’est pas important. La traversée n’est rien. Seules la chute ou son absence ont un poids.
Icare : si je ne tombe pas, je pourrais continuer à douter. Si je tombe… Tout est une question de choix, car la mort n’existe pas ! Je sais que cela paraît absurde, mais la seule façon de mourir est de se suicider.
…
Maya : avec un gibet, haut dressé, tel un rapace aux longues ailes de nuit. L’image peut être séduisante.
Icare : je ne comprends rien aux apparences. Je ne sais pas jouer
Maya : j’imagine l’orpailleur solitaire. À ses pieds coule un fleuve. Autour de lui danse une forêt. Car les arbres ne marchent pas, leur mouvement est une ondulation, une élévation, comme s’ils étaient appelés d’en haut… Par le vent sans doute. L’homme solitaire s’est enfermé dans une pensée unique, presque dans un geste. Son regard est perdu, comme noyé, dans une infime parcelle de sable. Un saumon nage mais il ne le voit pas. L’or seul, sa présence hypothétique, tout au moins, le pousse à vivre.
Icare : ce pauvre parmi les pauvres, puisqu’il s’est lui-même dépossédé de tout, sera-t-il riche un jour, s’il trouve de l’or ?
Maya : toujours tes questions !
Icare : la mort est le résultat de nos appétits, de l’étroitesse de nos vues… Je parle de nous, enfin, de moi…
Maya : si cela pouvait être vrai !
…
Icare : de mon corps ou plutôt de ma chair, ce corps apparent. Cette viande vouée à la destruction. Cette enveloppe qui peu à peu m’assassine, tranquillement, avec mon consentement, car je pourrais oublier cette part superflue de moi-même, et ainsi préserver ma survie pour l’éternité. Seulement, à simplement penser me délester de mon apparence, je me cabre tel un cheval aux portes d’un abattoir.
Maya : l’image m’est pénible ! As-tu déjà regardé un troupeau de chevaux sauvages, entité indivisible. La vie ne se peut réduire à un seul individu.
Icare : je ne détiens pas le secret du cheval. Mon existence dépendra de mon choix. Face à lui je recule. Je voudrais vivre, bien sûr, et aimer sans doute… Mais sans perdre la chair, ses plaisirs et ses crimes…
Maya : contente-toi de vivre ! La montagne existe et ne se pose pas de questions. Prends-la, elle t’attend… Et moi aussi j’existe.
Icare : le corps est un fardeau autant qu’une jouissance, lorsqu’il se trouve associé à la douceur d’une peau d’où montent les senteurs de muscles encagés.
Maya : la chair, toujours, ainsi que le sang…
Icare : j’aimerais tant perdre ma matière !
…
Maya : j’ai besoin, pour aimer, de preuves matérielles. Il me faut sentir la vie couler sous mes doigts. J’aimerais être une source. Le balancement d’un arbre, prêt à tomber. Une fauvette, en plein vol, endormie et rêvant, peut-être. Un de ces fauves miniatures à la carapace dure et friable pourtant.
Icare : Une femme, aussi, perdue sur ma rive et qui divaguerait.
Maya : la solitude, pour être belle, exige le partage.
Icare : j’aimerais me perdre en moi-même. J’aimerais, tout autant, m’oublier.
Maya : sur les rives de l’oubli danse mon double. Un arbre désespéré, bientôt, tombera. La forêt se sentira orpheline. Il me semble entendre sa voix. Lointaine et assourdie.
Icare : les oiseaux pleurent-ils lorsque meurt un insecte ?
Maya : ils ne pleurent pas, ils mangent !…
Icare : il me semble parfois que ma connaissance de l’amour, mortel, reste incomplète tant que le désir de l’autre, lorsque cet autre est femme désirable, ne s’est pas transformé en faim de sa chair. Car la faim assouvie est la forme extrême du désir.
Maya : une vipère sous la roche. Nourriture probable pour un autre prédateur. Comme un caillou jeté dans une eau morte. Le vol d’un rapace, ses ailes sont immobiles. Dans l’eau, plus bas, un poisson avale une libellule…
…
Icare : à quoi pensait-elle au moment de mourir ? À vivre sans doute. Qui est le meilleur ami du mouton ? L’herbe qu’il broute ou bien l’homme qui le mange ?…
Maya : je suis ton amie et j’ai faim de toi. Pourtant, je ne veux pas te dévorer.
Icare : la survie est un choix : vivre de ses amours en les dévorant ou bien vivre l’amour… Sans doute…
Maya : tu pourrais penser à me déguster.
Icare : le cannibalisme doit être agréable…
Maya : viens…
Icare : mais toujours je me refuserais ce plaisir ainsi que l’assurance de vivre infiniment.
Maya : je te comprends !… Vivre sans plaisirs !
Icare : je serai donc mon propre équarrisseur mais jamais ne deviendrai un amant cannibale.
Maya : il existe des nourritures qui ne se peuvent prendre sans risques de se perdre. La condition d’humain impose des devoirs.
Icare : suis-je seulement humain ?
…
Maya : un jour je prendrai mon envol. Le soleil commencera à poindre. Les oiseaux s’éveilleront à peine. J’aurai à l’oreille le murmure d’un ruisseau.
Icare : quelques gouttes de pluie, rosée plutôt qu’averse, t’accompagneront.
Maya : je me serai allégée, sans doute, du poids de ma mémoire.
Icare : tu ne porteras plus les chaînes de ton humanité.
Maya : mon esprit volera par-delà les montagnes.
Icare : ton corps suivra… Peut-être…
Maya : un lièvre détallera, décelant ma présence. Je ne le poursuivrai pas.
Icare : le désir de sa viande t’aura alors quitté.
Maya : je m’élèverai, tranquille, sans dévier jamais, dans l’axe du soleil.
Icare : entre l’ange et la bête, l’homme trouve sa place. L’homme peut-il voler sans l’aide d’artifice, apprenant de la bête les parcours de l’instinct ? L’homme peut-il rester homme et se substituer, pourtant, à l’ange ? L’homme peut-il côtoyer la lumière tout en restant humain ?
…
Maya : la lumière, parfois, se révèle trompeuse.
Icare : le corps, souvent, reste silencieux face à la souffrance. Les mots fuient lorsque surgit la peur… Je redeviens enfant et me conte une histoire.
Maya : tu n’as jamais cessé de l’être ! Moi non plus d’ailleurs… Et j’aime bien les histoires.
Icare : apprivoise-moi, apprends-moi à aimer, je t’apprendrais la solitude, je te donnerai mon désespoir, dit le renard au petit prince…
Maya : la solitude peut être une arme pour briser les chaines. La solitude peut être une lumière perdue dans la nuit, une vague qui monte et nous emporte, un mascaret d’amour qui efface la peur, une amulette qui efface les cauchemars.
Icare : la solitude est un mot à apprivoiser, un continent vierge à découvrir.
Maya : la solitude, c’est moi, lorsque je deviens l’autre.
Icare : raconte-moi tes songes, donne-moi tes doutes, dit le renard à son miroir. L’amitié peut être une forteresse…
…
Maya : je l’imagine : quatre murs, impalpables et pourtant infranchissables si je m’y refuse. Une cascade, pour la joie du regard, qui peut se transformer en fontaine, pour la commodité de la soif. Un arbre centenaire en place de donjon ; le guerrier, en toi, laisse toujours la place au promeneur.
Icare : les douves sont un ruisseau où j’aurais, autrefois, poursuivi l’écrevisse, à la manière du chasseur de papillons plus que du pêcheur. Sur le cours d’eau, une brindille, en place de passerelle pour fourmi.
Maya : le soleil, bien sûr, t’accorderait sa lumière. En cadeau plutôt qu’en offrande. Le maître d’un château a des alliés puissants. Un crapaud et un hérisson te conseilleraient. Trois moineaux et un chardonneret formeraient ta garde.
Icare : j’aimerais aussi qu’une renarde, flanquée de ses renardeaux, viennent parfois nous visiter…
Maya : dans tout homme sommeille un père de famille zoophile.
Icare : la souffrance est un chemin qui ne se peut parcourir en solitaire… Et pourtant… Que serais-je sans la souffrance ?… Quel serait mon devenir si je ne connaissais pas la peur ?
Maya : je peux t’imaginer, à l’abri, dans un potager. La tête bien au chaud, cachée dans la terre, enfoncée.
…
Icare : tel un légume. Mes pensées seraient enfouies. Les racines de l’homme se trouvent dans son cerveau.
Maya : la lumière, souvent, est source de douleur. Le prisonnier, trop longtemps enfermé, souffre de sa liberté retrouvée. Ainsi en est-il, sans doute, de l’aveugle retrouvant la vue.
Icare : je sens la caresse du vent. La peur est partie. Il m’arrive de ne plus éprouver de plaisir à vivre !… Le désespoir peut-être… Alors, parfois, je m’invente des histoires de renard et puis de petit prince descendu d’une étoile… Je sais bien que cela n’est pas vrai… Qu’il n’y a jamais d’amour totalement innocent… Mais je préfère les petits princes qui refusent de grandir et parlent aux renards.
Maya : un petit prince ne devrait jamais grandir ! Il ne devrait surtout pas devenir l’un de ces tueurs de loups qui n’ont rien fait de mal…
Icare : sauf à un mouton…
Maya : une fois par semaine…
Icare : il faut bien que tout le monde meure…
Maya : et surtout il ne faudrait pas qu’il se gonfle de certitudes…
Icare : comme les outres avec le vin aigre.
…
Maya : ou bien encore comme ces nuages noirs annonciateurs de malheurs futurs, ils pinceraient leurs lèvres minces à la vue d’un petit prince et d’un renard, s’apprivoisant l’un l’autre, dans l’ignorance joyeuse des règles de la morale et de la bienséance.
Icare : souvent, d’ailleurs, le petit prince est une princesse. Ou bien le renard est une louve… Mais jamais il ne leur viendrait l’idée d’aller fonder Rome.
Maya : je ramasse un peu de terre. Presque rouge me semble-t-il ? Fluide… Comme des graines… Il neigera bientôt.
Icare : la densité de l’eau sera plus forte que celle de cette terre.
Maya : la matière est une.
Icare : à quoi pense-tu ? murmure une voix lointaine… Je ne pense plus. Je goûte aux secondes qui fuient et qui sont les dernières. La cascade se fige lorsque l’hiver arrive. La mort n’est peut-être qu’une attente… Une de plus.
Maya : le chat se fige lorsque chante un oiseau. Sa vie, comme suspendue au fil de son désir, alors qu’elle se concentre…
…
Icare : nous connaissons ainsi de nombreuses morts.
Maya : la première goutte de sang qui coule, la première émotion partagée, fut toujours précédée d’une attente, absence de vie apparente.
Icare : la mort viendra. Je suis prêt et j’attends.
Maya : si tu étais vraiment prêt, tu n’attendrais pas.
Icare : l’ombre du vide plane sur mes certitudes. J’étais sûr de mon corps et lui confiai mon existence. Je ne serais plus, bientôt, que l’empreinte d’un rêve passé. S’agit-il d’un suicide ou d’un assassinat, je ne saurais le dire ?
Maya : qu’importe finalement la raison du départ, le saut dans le vide demeure toujours la source principale de nos peurs.
Icare : il me faudra donc mourir. J’aurais aimé, pourtant, connaître une vieillesse paisible. La mort serait venue me visiter, à intervalles réguliers, sans doute, comme un propriétaire souhaitant goûter aux fruits de son verger – qu’il prête, plus qu’il ne loue, à un voisin ancien. À chacun de ses passages, une part de moi-même l’aurait suivie. Mes jambes d’abord seraient parties, car, en ces temps de paix et de sagesse, je n’aurais plus eu besoin de me déplacer. J’aurais ensuite perdu la vue, peu à peu, comme un rideau que l’on ferme avant de se coucher. Ma vision intérieure serait devenue plus vive. Puis mes oreilles se seraient fermées aux bruits importuns. J’aurais pu vieillir sans me hâter. Seulement, la mort est un cadeau que je ne peux refuser.
…
Maya : le cerf qui fuit devant les chiens arrête de vivre. Le danger ne vient pas du couteau de l’assassin mais de la peur de la victime.
Icare : je ne veux être ni bourreau ni victime.
Maya : tu ne peux éviter l’inéluctable mais il t’est possible de ne pas en tenir compte. Tu peux, si tel est ton souhait, aimer, écouter, sentir, tout et peut-être n’importe quoi, pour le plaisir, pour grandir, pour ne pas penser seul, parfois pour ne plus penser du tout, mais toujours pour ressentir, vivre, renaître.
Icare : naître, mourir, renaître… J’aimerais bien changer un peu !
Maya : tu peux, dans un seul geste, naître et mourir. Tu peux exister, non pas à travers l’autre, encore moins malgré l’autre, mais avec lui. Il te suffit, pour cela, d’accepter de vivre, de comprendre la vie, de partir à sa recherche. Exister, ce n’est pas respirer, mais se dédoubler. Exister c’est se voir en face.
Icare : je te regarde et j’ai l’impression d’exister.
…
Maya : une voix lointaine et inconnue, faite de souffles, de silences et de mouvements, chante dans ma mémoire…
Dans la mouvance du souffle
Oû rôde l’ombre meurtrie
De multiples éclats de vie
Deux solitudes ignorées
Parfois se rencontrent
Et progressent en s’aidant
Puis se séparent
Leurs forces ranimées
Et s’élancent vers l’infini.
Icare : je suis le solitaire ainsi que le miroir. Je suis le compagnon de ma propre solitude.
Maya : je suis le nuage qui devient rivière. Je suis la cascade rencontrant la brume.
Icare : je suis le feu répandu sur la terre. Je suis le vide et l’équilibriste.
Maya : je suis la nuit éclairée.
…
Icare : je suis ma mort ainsi que mon géniteur. Je suis le souffle ultime du trépassé. Je suis le repos de l’éternité. Je suis le néant qui me questionne.
Maya : une falaise abrupte. Une cascade en chute libre. Deux ou trois rochers en contrebas. La montagne, aussi, a besoin de racines.
Icare : la nuit, bientôt, remplacera le jour. Les vautours arrêteront de tourner. Le silence sera mon linceul.
Maya : demain est une page blanche.
…
Un chat entre deux âges, comme on le pourrait dire du poisson nageant entre deux eaux, aime un oiseau d’une espèce inconnue. Souvent nous nommons inconnu ce que nous connaissons de la manière la plus intime. Le danger découle de la proximité. L’homme et le roseau proviennent d’une matrice unique mais seul le roseau écoute les leçons du vent.
Le chat aime l’oiseau d’une tendresse anthropophage. Les nourritures, qu’elles soient physiques ou spirituelles, répondent au même besoin, prendre la force à sa source.
J’aime une salamandre au regard de louve. Je dévorerais son regard afin, qu’ensuite, elle puisse se repaître de mon cœur.
Trois renardeaux orphelins.
Un vautour qui plane silencieux.
L’arbre plonge dans le précipice…
L’obscurité recule, chassée par le vent.
…
7
Une route qui se perd. Un ruisseau presque endormi. Une voiture, au loin, poussive et maladroite. Un regard distrait qui découvre l’absence.
Comme un oiseau écrasé au milieu de la route que prendrait dans sa main un géant lunaire. Cet enfant de grande taille, même pour ceux de son espèce, regarde rougir sa main.
La mort aussi est un partage.
Le géant avance, le regard fixé, toujours, sur sa main, rouge du sang de l’oiseau qui ne chantera plus. L’homme pleurerait si cela lui était permis. La vie ne se soucie pas de nos désirs secrets.
…
Pluie d’Automne. Gouttes d’eau presque froides sur une gare oubliée, de campagne ou de banlieue, la médiocrité méconnaît la géographie. Son silence est usé comme d’avoir trop servi. Ici vit le désespoir, cette solitude sans humanité.
Assise sur le quai, une femme, presque une enfant, comme semble l’indiquer son sourire, attend… Sans doute un train… Qui ne viendra pas ? Ou bien un ami. À moins qu’elle ne se fusse posée, là, guidée seulement par le hasard.
Une gare désaffectée, quelques bancs désormais inutiles, la pluie s’est arrêtée. Un homme marche, son pas est sûr, comme habité d’une conscience, étrangère peut-être, aux pensées de l’homme.
Lui : une vie passée à attendre un signe.
Elle : qui ne vient pas…
Lui : une vie gâchée, sans doute, par cette ombre sur le miroir, chaque matin. Cette ombre que nous sommes seuls à voir et qui, sans doute, n’existe pas. Une vie passée, sans connaître jamais, ni plaisir total ni chagrin accompli.
Elle : une vie sous haute surveillance, comme entre parenthèses. Une vie meurtrie par notre propre indifférence. Une vie traversée, les yeux fermés, à rechercher une saveur, un parfum, improbables témoins d’un bonheur enfoui.
…
Lui : comme si le bonheur existait… Je veux dire, comme si le bonheur vivait. Et, de ce fait, pouvait agir à sa guise, venir et partir, s’emparer de notre vie, la façonner, puis, subitement, s’enfuir très loin.
Elle : comme si le bonheur était humain, vivant de sa propre existence ?
Lui : comme si nous n’étions pas nous-même des êtres vivants. De ce fait, doué de cette faculté particulière à l’homme que l’on nomme bonheur.
Elle : je ne suis pas heureuse ! Comment le pourrais-je alors que chaque heure me rapproche de la mort, que chaque jour vécu me détruit un peu plus ?
Lui : avez-vous, de nuit, écouté le balancement régulier d’une horloge ? Ce battement immuable, trouant le silence ou l’enluminant. Mais n’est-ce pas la même chose ? La tache rouge sur la feuille, tout comme l’image d’argent ou d’or autour de la lettre, ont en définitive la même fonction : attirer notre attention sur l’essentiel.
Elle : je ne peux entendre le silence !
Lui : ainsi est l’horloge, dans la nuit qui nous signale le passage du temps, pèlerin immobile, qui nous rappelle à la vie, ce bonheur en mouvement.
…
Elle : avez-vous, une fois dans votre vie, regardé le ciel après la pluie ? À son extrémité, une chaussée pour piétons ailés ouverte, lorsque les conditions climatiques sont bonnes, sur une porte. Il ne faut pas la passer comme le feraient les touristes avides, seulement, de dépaysement facile.
Lui : il ne faut pas non plus venir avec, à l’esprit, l’image d’un monde achevé et stable. Ici règne le mouvement.
Elle : au-delà de cette porte avance une route, de glaçons assemblés, non-pas banquise mais réceptacle.
Lui : collection d’écrins pour eau vive.
Elle : sans commencement ni fin.
Lui : sur cette route, quelques rares voyageurs.
Elle : connaissent-ils leur destination ? Je ne saurais le dire… Désirent-ils la connaître ? J’en doute !…
Lui : l’incongruité de leur situation ne parait pas les étonner. Le froid ne semble pas les gêner.
Elle : souffrent-ils ? Sans doute, mais ils l’ignorent.
Lui : ils restent insensibles, aussi, à la beauté de cette route.
…
Elle : ils ne la remarquent pas.
Lui : ils ne voient ni la route ni sa beauté.
Elle : sentent-ils la route sous leur pas ?
Lui : peut-être, mais cette sensation reste d’ordre physique, uniquement, le cerveau demeure une mécanique.
Elle : nulle part n’est accordée à l’intelligence, à l’imagination, aux émotions ?
Lui : ainsi nous comportons-nous souvent, robots ivres, mécaniques imparfaites, inconscientes.
Elle : le bonheur est notre route mais nous ne le savons pas.
Lui : le bonheur, la mort et la souffrance furent les trois dons offerts à l’homme par la vie.
Elle : trois dons indissociables…
Lui : notre seule trinité.
Elle : la mort, cette ultime borne du temps, cette horloge vitale. La souffrance, cette porte ouverte sur la tolérance, sur l’imagination.
…
Lui : le bonheur, cette capacité à être, cette voie d’accès à la plénitude.
Elle : une vie passée à attendre…
Lui : d’être heureux, d’être différent, d’être un autre.
Elle : une vie passée à chercher…
Lui : une ouverture, une route, un autre monde.
Elle : une vie passée à se fuir.
Lui : l’existence est affaire d’imagination. Sans elle, nul choix n’est possible, sans choix…
Elle : la vie dépérit.
Lui : la vie provient de notre volonté, de notre désir, à imaginer l’univers, fut-il infime parcelle de vie.
Elle : je ne sais plus rêver.
Lui : une hutte de pierre, presque une caverne. Plus refuge qu’habitation. Pierres posées l’une sur l’autre. Sans mortier. Seul l’amour, semble-t-il, les relie. Ses habitants anciens étaient des bergers, puis vinrent les promeneurs en quête de solitude.
…
Elle : je n’aime pas être seule. J’aime à me sentir entourée, comprise, aimée… Comment peuvent-ils rechercher la solitude ?
Lui : pas celle des villes, cette tueuse ! Celle, amicale et tendre, qui accompagne les jeux des enfants libres. La liberté des enfants ne ressemble pas à la notre, souvent imparfaite. La liberté de l’enfant est un univers se suffisant à lui-même.
Elle : univers clos. Presque autistique ?
Lui : sans doute ! Mais c’est un univers sans limites contenant le monde de l’adulte autant que celui des fées. Dans ce refuge en pierres règne la solitude libertaire des jeux d’enfants. Ici, point de meubles, pas de porte non plus, juste un passage ouvert à tous.
Elle : je ne viens pas ici pour dormir mais pour rêver. Je ne rêve pas ici pour fuir mais pour trouver… Une porte, un passage, une autre solitude, le balancement de l’horloge éternelle.
…
8
Tintinnabulement orange des clochettes. Une porte s’entrouvre comme un arc-en-ciel, lumineux mais pas trop. La lumière se doit d’être discrète, son efficacité est à ce prix.
Le prix, la valeur, non marchande, de ce qui ne nous appartient pas. Le poids d’une vie unique sur une autre vie (la nôtre) Le chemin fécond comme un ventre de femme à maturité. La fécondité est-elle signe de richesse ?
Je pense à ce paysan qui perdit son cheptel par amour du gain. Il disait aimer ses brebis, sa terre, son métier, sa femme ainsi que ses enfants. Certains périrent de faim, d’autres de solitude. Lui seul est resté. À côté du dernier arbre, moribond, de son verger.
La nuit, parfois, je pense à la ville, à celle-ci ou bien à une autre… Toutes finissent par se ressembler lorsque l’obscurité envahit mes pensées, lorsque mon esprit baisse sa garde et glisse dans le gris de l’habitude. On ne devrait pas s’habituer. Seulement, il y a la routine, cette forme hypocrite de l’indifférence, alors la nuit, avec la fatigue, la ville m’envahit. Pas n’importe quelle ville. Une ville idéale. Un idéal de laideur. Un monstre froid et sec, nu et vide, stérile, qui monte un à un ses murs de béton, qui dévore peu à peu mon espace, qui m’absorbe… À moins que ce ne soit moi le dévoreur… Peut-être, oui, peut-être est-ce moi qui rêve de festins d’immeubles en tranches, de parpaings sur canapés. D’habitude, l’indigestion précède le cauchemar… Dans mon cas, elle est le cauchemar. Je sens l’implosion me guetter. J’imagine mon corps servant de fondations à une cité de béton.
…
La chasse aux trésors n’est pas encore fermée. Il faut se méfier des apparences. Le moins humain des labyrinthes, la ville la plus froide, peuvent se transformer en désert autour d’une oasis. Tout est une question de regard.
Il est, ici même, un espace hors du temps, hors de ce temps, tout au moins, la différence est grande. Autour la ville, dessus un stade… Je ne suis pas fanatique des stades. Trop de fantômes déplaisants leur sont attachés. Supporters chauvins et violents sur les gradins. Prisonniers, sur la pelouse, en partance pour l’enfer… Ce stade est différent… En surface la routine mais dessous commence le rêve… Ombres d’hommes et de chevaux venus boire, tous sont réunis auprès d’un lit de ruisseau reconstitué. Plus loin, une canalisation du quatorzième siècle. Presque rien, en fait, des fouilles archéologiques. Je n’aime pas le passé, les fossiles, les musées. Je n’aime pas, non plus, les imitations, les commémorations, le respect dû aux martyrs. La vie, et elle seule, m’enchante, me transporte, me transforme. Le fantastique, les contes de fées, le surréalisme, sont des aberrations. Images figées, mortes et honteuses de l’être de la réalité. Tentatives maladroites et vaines pour expliquer. Tout ne peut, ni ne doit, l’être. Nous sommes un vaisseau que nous méconnaissons. Le plus intéressant, chez nous, se trouve en dessous de la ligne de flottaison.
…
Quatre murs de béton. Une porte métallique pour unique issue et seul le silence impose sa présence. Ici, le temps n’existe plus, il s’est enfui avec ma mémoire. Chaque homme est une histoire, mais suis-je encore un homme ? J’ai connu la solitude, j’ai cru rencontrer l’amour, mais ce n’était que l’ombre de mes peurs. Peur d’être seul, peur d’être différent, peur de ne plus être… La recherche de l’amour, si elle n’est pas désintéressée, peut être un mirage. La peur et l’attente ne sauraient être de bons guides. Sans doute portons-nous une part d’enfer, le résidu de nos mesquineries, de nos inquiétudes. Sans doute sommes-nous un labyrinthe dans lequel nous nous perdons souvent. Il nous faut pourtant apprendre à vivre… Et l’amour reste le seul professeur.
La voix, le corps, les mots. Entre larmes et rires. La peur qui apparaît derrière nos gestes les plus anodins. Comme une transpiration un soir d’orage, comme un malaise soudain, indicible, presque imperceptible. Le presque change tout. J’ai presque terminé d’apprendre mes leçons dit l’enfant qui aimerait bien jouer et ne plus entendre parler d’école, cette presque prison qui pourra, peut-être, s’il la fréquente assidûment et sans se laisser porter à son penchant aux rêves, lui permettre d’entrevoir, un jour futur, l’avenir radieux dont parlent les chantres du monde fonctionnel.
…
L’enfant aux boucles brunes qui suivait, non sans mal, les cheminements d’une pensée étrangère (celle de l’adulte qui l’éduquait) a vieilli.
Trente années ont passé. Ses cheveux sont tombés avec ses illusions. L’avenir se confond avec l’horizon et, comme celui-ci, s’éloigne lorsque l’on s’approche. Un jour vient où avenir et passé se rencontrent. L’enfant aux boucles blondes n’a pas vécu.
Entre le rire et les larmes, tous deux refoulés, rejetés pour vice de forme, complaisance suspecte, à l’émotion sans doute. Ces larmes que nous refoulons parce que nous sommes trop grands, adultes disent-ils, comme si l’âge était une frontière séparant l’enfant que nous fûmes du manequin policé et servile que nous sommes parfois.
Entre ces règles non écrites, ces rêves qui se cachent, cette peur qui, sans doute, se refuse le droit à la dignité.
Je me sens parfois si petit. Entre l’enfant sauvage, ce chantre de la vie, et la machine à produire, à consommer, se trouve un abîme que le temps ne peut réduire. Et pourtant sauter serait si facile. Nous pouvons voler, mais nous méconnaissons notre pouvoir. La brume, autour de nous, est trop épaisse. Notre ignorance trop imposante.
…
Notre incapacité apparente est un rideau de fumée qui disparaîtrait si nous étions capables de rire. Comme çà. Sans raisons. C’est-à-dire avec les meilleures raisons du monde. Le désir d’exister. La volonté de vivre réellement. Le refus de la non-vie. Le plaisir d’entendre résonner des rires. Ces rires qui nous libéreraient si nous en connaissions la force rebelle. Ce rire qui nous transformerait, feuilles d’arbrisseau frissonnant à chaque souffle, en oiseaux libres et joyeux, heureux lorsque le vent se lève.
Parfois, de nuit, un mot ou bien une phrase m’impose sa présence. Comme un message secret réfractaire au décryptage. Les corps silencieux est l’une de ces phrases qui vinrent un jour me hanter. Depuis, j’en cherche la signification cachée.
Le silence des corps… Le silence des cœurs… Tel fut le lapsus linguae qui vint un jour me visiter (comme le dit parfois ma salamandre lors de nos joutes intimes)
La corporification du silence, cette énergie devenue matière. Les corps entendent-ils le silence ? Et si tel est le cas, peuvent-ils le reproduire, le pénétrer, faire corps avec ?…
Bien sûr, le cerveau, par l’entremise de l’oreille, perçoit le silence. Il s’agit ici, le cerveau et l’oreille en faisant partie, du corps, considéré comme un outil. Ou bien, dans le meilleur des cas, du corps vécu comme l’une des voix de la connaissance. Je ne parle pas de ce corps-là, mais du corps unique, de cette entité, qui échappe à l’individu ainsi qu’à l’individualisation. Corps mystique peut-être, mais non corps mythique.
Les corps resteront silencieux.
…
L’attente, le doute, la peur aussi. La peur insidieuse, incontrôlée. Mon corps en conserve le goût douceâtre, incertain, malsain. L’attente de l’autre, cet inconnu. L’attente de celui qui ne me ressemble pas, tout au moins pas encore. L’attente de ce qu’il fera ou ne fera pas. L’attente du geste qu’il accomplira ou n’accomplira pas.
L’autre est un miroir, son regard en tout cas, miroir déformant sans nul doute, et c’est heureux, car de cette déformation naît la vie. De la différence entre l’image de l’univers que je porte en moi et celle que me renvoi l’autre naît l’espace de création nécessaire à la vie. Non-pas la répétition du même instant vidé de son sens, de sa sève, vie factice, illusion de vie.
Adam vivait heureux. Comme tous les inconscients. Il n’avait pas à chercher sa nourriture, les fruits d’eux-mêmes s’offraient à lui. Lorsqu’il éprouvait le besoin de se reposer, les arbres se penchaient pour que les feuilles lui servent de couche. Les rivières venaient à lui afin qu’il puisse se désaltérer. Il pouvait aussi y voir son reflet, imaginer ne pas être seul, penser le paradis peuplé de créatures à son image. Il ignorait la solitude ainsi que la différence.
Sa rencontre avec Ève fut la rencontre avec la conscience, la rencontre avec l’univers, la rencontre avec la peur.
…
9
En arrière-plan : la forêt.
Plus près de nous passent quelques animaux…
Au premier plan : un miroir.
Adam prend la femme dans ses bras.
Le miroir se trouble.
Adam est nu.
La vie commence.
J’aime une salamandre aux ailes de flammes. J’aime ce feu autant pour les meurtrissures qu’il m’inflige que pour sa chaleur.
À l’exception des amis, ces tendres icebergs, luminaires incandescents de notre solitude, les hommes, souvent, ne sont que des ombres qui passent.
Les femmes, par contre… Les femmes sont un autre continent… Inexploré. Bien entendu, je souhaiterais les connaître. J’aimerais les comprendre… Mais j’ai peur. Peur d’être pris pour un voyeur, un rêveur ou bien, et c’est encore le pire, un suceur de vie cachée (non sans peine)
Tordu marginal, briseur de frontières intersexuelles, individualiste anarchisant. Alors forcément, à moins d’être héroïque ou inconscient, mais n’est-ce pas la même chose ?…
J’ai la compréhension honteuse, sournoise. Il faudrait organiser des voyages : la femme, cette inconnue !…
…
L’homme est peut-être un animal social mais ce n’est pas l’ange de la communication !
Si j’étais fort, je ne chercherais pas l’amour, tel un nourrisson cherchant à téter. Si j’étais fort je ne chercherais rien. Je serais. Mais l’égoïsme est une valeur sûre.
Que sommes-nous ?… De pauvres hères abrutis de fatigue qui se traînent en attendant la mort. Ou alors, peut-être, un soir de désespoir…
Parfois on parle, simplement pour ne plus entendre le silence. Ce vide qui ne serait plus rien. Pas même l’ombre d’un corps, la trace d’une vie, la mémoire désagrégée d’une pensée défunte.
Parfois on rêve. Juste pour entretenir l’illusion d’une idée. Parfois aussi la machine prend le dessus. Le corps marche comme malgré lui. L’esprit se ferme, se fige, pour la sauvegarde de l’espèce, pour la gloire de la civilisation, comme preuve de notre intelligence ou bien de notre savoir faire… Mais il ne s’agit que de prétextes !…
Tout au fond de notre vide, très loin, comme un écho, hurle ce petit homme étriqué et violent. Perdu dans l’immensité de sa solitude. Cette solitude qu’il ne comprend pas, qu’il se refuse à comprendre. Parce qu’elle lui parle du néant, de la mort, de sa fin prochaine. Et, bien sûr, ce petit homme ne peut pas supporter.
…
La vérité est une bien étrange chose. Toujours changeant son apparence. Jamais préhensile dans son entité lumineuse. Peut-être est-ce mieux ainsi ?… Trop de clarté serait insupportable. Ainsi allons-nous dans l’océan de nos terreurs. Sans jamais toucher le fond. Sans jamais voir la lumière, l’amour, le vrai, l’unique, celui qui ne se conjugue pas, ne se rêve pas ne s’imagine pas, ne s’invente pas. L’amour, quoi ! Celui qui ressemble au vide, mais à un vide qui n’aurait pas peur de son ombre. Un vide qui ne se poserait pas de questions. Un vide qui serait la réponse. Un vide sans frontières. La vie et la mort n’auraient plus de sens. Il n’y aurait plus de temps qui passe. Il n’y aurait plus de couleurs. Il n’y aurait plus d’hommes ni de femmes. Seul resterait l’amour… C’est sûrement possible mais peut-être est-ce trop demander, peut-être faut-il être patient, peut-être suis-je trop exigeant ? Seul l’espoir est une attitude rationnelle.
L’appui est ferme, stable, comme une terre fertile. Un arbre pousse ses plus hautes branches vers le ciel. Je me fais liane, lierre, liseron. Liaison entre l’humus et l’infini. Je grimpe, le regard levé, comme ces pierres dressées sur la lande, défiant l’univers. Non point pas goût pour l’insolence mais pour le pousser dans ses retranchements, l’aider à grandir, à se perpétuer, à devenir. Cromlech de chair, pierre levée, droite mais non rigide, vivante. Pierre souple qui avance et martèle le sol comme pour en prendre possession. Chaque pas reproduit le pas qui le précède. Chaque mètre parcouru est un espace gagné sur le temps. Chaque seconde qui passe est un grain engrangé, particule aurifère pour la mémoire de l’homme. Le souvenir témoigne de notre devenir.
…
Le temps est une route qu’il me faut parcourir les yeux clos. Le regard devient plus vif lorsque tombe la nuit. Seule la lumière, lorsqu’elle nous est familière, nous transforme en aveugles. Les infirmités de l’esprit sont plus graves que celles supportées par la chair. Le temps est une route qu’il me faut parcourir en solitaire. Comme ces terres où se cachent d’antiques trésors qu’il fallut retourner, pierre après pierre, avant d’en connaître le secret.
Une flaque d’eau, comme un miroir, pour les cieux sans doute. Un enfant, cassant le miroir, joue au démiurge. L’innocence est un fléau naturel.
Silence du petit jour. L’automne est parmi nous. Grondements, chocs, cris, les rumeurs de la ville m’entourent. Je cherche le silence caché. La violence, peut-être, provient de la solitude. Mais pas de n’importe laquelle ! D’une solitude écartelée, vide et sans esprit. D’une solitude devenue prison et non pas espace offert à toutes les libertés de l’âme. Entre mon âme et moi existe parfois une faille où peut s’infiltrer le désespoir. Comme une vie qui se perd.
La ferveur parfois, comme si le doute oubliait, ouvre une porte à l’espérance. La nuit est entrouverte, tel un fruit obscur, chantant. Le silence interpelle la lumière.
…
L’arc-en-ciel après la pluie, tel un regard perché, réconcilie l’homme avec l’univers. Le ciel est une réalité fluctuante. Un nuage gorgé d’eau le transforme moins aisément que la moindre de nos pensées.
Une impulsion, comme l’un de ces ressorts libérant un piège, qui nous pousse à entreprendre un voyage sans connaître la destination. La réflexion se fait inutile fardeau. Le destin est notre guide. Je ne crois pas plus au destin qu’au hasard. La vie ne se peut écrire. La vie ne se perd ni se gagne. Elle se construit puis se parcourt sans jamais pouvoir revenir en arrière. D’or et de sang se trament mes souvenirs. Je connais mon passé mais n’en suis point le maître, heureusement, le présent seul est une ouverture. L’espérance est un trésor caché. Nous ne sommes pas. Nous devenons. Avancer ce n’est pas marcher mais marcher en s’élevant. Bientôt viendra l’oubli. Une page vierge s’ouvrira.
…
Le souffle du vent à peine perceptible, tendre et discret. Un brin d’herbe qui renaît. Un chuchotement, presque un silence, juste coloré. Un bosquet au loin qui ondule, mouvement à peine esquissé, vestige d’une forme agissante encore et dont pourtant la fin même aurait été oubliée. Une impression fugitive. Presque suggestion subliminale. Une saveur inconnue proche du parfum plutôt que du goût. Un murmure, seulement perceptible pour ceux qui désirent l’entendre, et qui renforce l’intimité entre ces ombres passantes. Un corps, aussi, qui s’offre sans le savoir à la lumière du soir. Une rencontre imprévue, furtive, comme le vestige d’un rêve. La voix sonne claire à mes oreilles. L’image d’une eau pure, douce au palais, parfumée. Le contact fut rapide. Geste d’invitation au voyage presque esquissé. Pression, à peine réelle, de deux paumes l’une sur l’autre. L’impression reste puissante.
Depuis je cherche… À comprendre, à expliquer, à transmettre, à ressentir, c’est-à-dire à sentir de nouveau. Le partage est une joie que je ne peux refuser. Pouvoir, vouloir, quelle différence ? Offrir, c’est un peu s’offrir, se donner à l’autre, s’ouvrir à la vie. L’offrande est une voie d’accès au monde. Non-pas seulement aux autres, mais à l’univers, cet autre nom de la vie.
10
Il y avait une porte blanche et lumineuse. Un bruit doux et tendre, presque caresse, plutôt soupir. Comme une plainte, un appel, une demande. Formulée du bord des lèvres afin de ne pas ternir l’intimité de la bouche, cavité buccale, presque caverne, entrée d’un gouffre, ouverture sur l’au-delà des songes, la face cachée de la raison. Lèvres juste entrouvertes. Parfum subtil de la femme. La voix bientôt libérée. Le regard profond, sans aucun doute, le corps aussi, son mouvement dessiné à peine. Vie cachée, source ou fontaine… Peut-être…
Silence, comme un sanctuaire, non-pas église mais tabernacle pourtant. Défenses à investir une à une.
Défenses, redoutes, forteresses, fortifications, bosquets impénétrables, doutes silencieux, peurs contenues, violence réduite en esclavage.
Il y eut une autre porte. Bleue et mouvante. Un silence, puissant et vaste, comme une vague, un courant, une source tendre et amère, un peu, une vie muette et agissante, offerte.
Il y eut enfin une lumière franche. Et puis le silence. Comme une promesse.
…
L’espoir, la nuit, le silence. Un regard chargé tel une arme, non-pas fusil ni même poignard, qui pourtant serait plus proche de la vérité par l’image qu’il impose : deux corps associés comme le seraient des complices, mais plume qui écrit et transperce.
L’espoir, la nuit, le silence. Une voix portée au rouge. Oeuvre d’alchimiste et non de comédien. Les mots sont comme des galets emportés par une vague. Ici, l’éternité remplace l’océan. Mots porteurs d’émotion et de tendresse. De sens aussi. À l’état brut, dépouillé de sa gangue de raison, conventions, habitudes…
L’espoir, la nuit, le silence. La nuit comme espace de liberté. Une nuit opposée à toutes contraintes géométriques et temporelles. L’espace-temps est oublié. La joie devient l’unique dimension du monde. L’espoir s’est installé au cœur du silence.
Jour et nuit mêlés. L’œuf originel. La goutte de vie primordiale. Matière et énergie confondues.
Le rythme devient lente vibration, rythme irrégulier. Pulsation teintée de sens. Une phrase apparaît, puissante et fluide, mascaret serein et rigoureux, vivant et sensuel. De la rigueur naît l’extase. La phrase, musicale maintenant, enfle et se transforme. Une étoile apparaît. Naissance de l’univers. J’entends le sang couler dans mes artères, source jaillissante de la roche, images de feu, ombres de lumières. La pensée devient chair, squelette, matière en fusion, entre torrent et lave. Je suis arbre qui grandit. Flamme animée par le souffle vital. Ma gorge s’ouvre. Ma voix jaillit enfin.
…
Dans un souffle, dans un silence,
Dans un mouvement esquissé à peine.
Dans une impression fugitive,
Une senteur sans affectation.
Dans un murmure à peine perceptible.
Dans l’orbe d’un corps à peine entrevu.
Dans la douceur d’un souffle offert.
Dans ces rencontres fortuites.
Dans cette joie partagée
Qui nous submerge.
Dans ces vagues d’amour
Si réelles et si vastes
Que l’on s’y peut oublier.
Dans chacun de ces instants
À nul autre pareil
Comme des sanctuaires de tendresse,
Des gouffres de félicité.
Dans cet espoir trouant la nuit de nos doutes.
Dans les regards échangés, comme jetés,
Dans les soupirs contenus, comme emprisonnés.
Dans nos nuits trop sombres
Pour nos habitudes de clarté sans risque.
Dans nos murmures cachés tels des reproches.
Dans nos ambitions transparentes et vaines.
Dans nos courses à perte de vie.
Dans nos étranges conciliabules
Avec l’éternité cachée qui nous hante.
Dans nos colères et nos terreurs.
Dans nos erreurs et nos doutes.
Dans nos deux vies.
Celle que nous croyons vivre
Et celle que nous vivons en rêve.
Dans nos rencontres avec l’absolue sagesse.
Dans celles avec l’infinie bêtise,
Notre sœur tant aimée, immortelle compagne.
Dans nos crimes secrets.
Dans nos élans d’amour,
Dans nos calculs inutiles et sordides.
Dans nos dons sans réserve.
Dans nos désertions soudaines.
Nous sommes nos racines,
Cultures austères et humbles
Que chante notre sang ?
Nous sommes le début du monde.
Vie et mort mêlés.
Enfantelet aux yeux avides.
Nous sommes la sagesse,
Sombre et ultime issue,
Sublime ruine dérisoire
De notre innocence perdue.
Nous sommes l’infinie douceur
Qui résonne en nos cœurs
Comme gronde la foudre
Quand les cieux se révoltent.
Nous sommes le murmure de l’univers
Qui jamais ne se tait ?
Nous sommes le temps,
L’infinie variation,
Ce long fleuve de l’éternité.
…
Il me faudra partir. M’abandonner au courant. Il me faudra laisser mon esprit comme l’on se défait, à la saison des mues, d’une vieille peau et que l’on est reptile. Il me faudra oublier l’homme ainsi que l’animal. Ces deux entités qui se déchirent et me possèdent. Je deviendrais arbre, fleur, herbe, grain de sable. Je serais la voix du vent dans le désert des larmes. Je serais le vide qui jamais ne s’emplit. Je serais la chute du temps. Je serais la fuite des feuilles. Je serais silence à l’écoute du monde. Je serais le feu et l’eau. Je serais la matière et son absence. J’intégrerais l’univers. J’irais, solitaire et serein, à ce festin de cendres. Je m’offrirais pour nourriture aux passants affamés.
Je fus géante rouge, je deviendrais graine de vie, source intarissable. La vie est une spirale, mais la peur est un gouffre.
Les chants de la terre montent dans le soir. Ciel de neige, la ville s’endort, le silence s’est installé, comme une lumière profonde et subtile. Qui suis-je face à la solitude ? La pensée peut être une compagne. Encore faudrait-il qu’elle touche à l’universel. Mon avenir sera l’enfant de mes rêves. L’imagination est la seule ouverture. La seule porte vers la vie.
Entre asphalte et nuages, une ville s’est levée. Un dernier rêve, presque un cauchemar. Mon petit garçon est mort. Je le savais mortel et passais le temps à m’agiter, à remuer sans avancer. J’oubliais que le temps ne m’appartenait pas, que je n’avais pas le temps de dormir, de me perdre dans les méandres de rêveries factices, de tourner comme un derviche sans conscience. Seul mon confort égoïste m’occupait. J’accumulais les actions stériles comme un avare, craignant de vivre, s’entoure de pièces d’or.
Je n’ai jamais eu d’enfant.
…
Je suis comme un aveugle et pourtant mes yeux ne sont pas morts. Je dois apprendre à regarder, à saisir les pensées avant qu’elles ne s’envolent. Je dois aussi apprendre à les réchauffer entre mes mains, à les couver afin qu’elles fleurissent puis à surveiller leur croissance, avec passion, avec patience, comme un jardinier, un amant ou un père. Je dois enfin accepter de les regarder partir, grandir, se multiplier, se donner à de multiples amants.
La nudité la plus crue. La peur, dépouillée d’elle-même, seule, face à son propre cri, confrontée à son néant, exsangue le corps lisse en apparence. Comme un lac qui repose, parcouru seulement par de furtifs courants, comme des veines mouvantes aux graciles caprices d’elfes libertins. Et puis l’attente. L’attente qui est absence de mouvements et qui pourtant est souffle. Souffles multiples en perpétuelle errance, mouvements imperceptibles, éoliens. Microscopiques fusées comme des points sans couleur que l’œil non averti confond. Et pourtant chaque souffle, comme une tache sans forme ni apparence, pour celui qui ne sait voir, est plein d’une vie complexe et unique, en mouvement. Chaque vie de chaque souffle, aux autres vies, dissemblable. Comme ne le peut imaginer l’homme pressé confondant mouvement et dispersion. Cet homme, malheureux sans doute, qui prend son refus de l’autre pour preuve de sa propre cohérence.
…
Chaque souffle parcourant le corps sans cesse, sans faiblir, semblable en cela aux autres souffles innombrables. Chaque souffle est énergie pure et ces points sans nombre, qui se confondent mais ne se mélangent pas, forment la vie à eux tous. La vie qui est peur et attente. La vie qui est énergie, la vie qui porte et anime, et chante en nous lorsque, dénudée, chante la peur.
Dans la nuit obscure je partirais. Le silence se fera oubli. La vie ne sera plus que vide. Les mots perdront leur saveur, leur sens, leur empreinte. Dans ce silence sans fin, dans l’oubli des semences de l’espérance, uniquement préoccupé par ma petite existence, me dissolvant peu à peu, je finirais par me perdre, m’oublier.
Dans ce silence sans fin. Dans l’oubli des semences de l’espérance, uniquement occupé de moi-même, me dissolvant peu à peu, je m’oublierai.
Dans cette vie qui ne sera plus que vide, tournoyant sur elle-même comme une sculpture morte, et d’elle-même affamée, tendre complainte qui n’aurait plus de sens. Sans but. Sans foi. Sans nourriture. Comme ces amours, vidés de leur substance, transformés en greniers, détrousseurs de nos solitudes. Les mots, détrousseurs de nos solitudes, ornés d’oripeaux au parfum d’habitude, les mots, sitôt prononcés, seront oubliés.
…
Dans la nuit obscure, je partirai, chevauchant les plaines désolées et les immensités fertiles de nos espoirs les plus hauts et les plus tendres, de nos douces splendeurs, de nos joies précieuses et furtives, de nos peurs renouvelées qui nous poussaient l’un vers l’autre, et nous ouvraient comme l’auraient pu faire ces clés magiques, dont parlent les livres anciens, afin qu’en nous entre l’univers.
Dans le silence de cette désertique plainte, toujours inachevée et qui ne peut mourir car elle ne sut naître. Unique et dense comme le néant et comme lui sans existence. Car la vie et l’oubli seront un. Les mots resteront, comme un espoir, presque comme un souffle, brindilles sur la mer.
Entre deux mondes.
Entre deux êtres.
Entre deux parcelles d’éternité…
…
Combien de temps, de sang, de boue, d’amour, combien d’espoirs trahis, pour bâtir en pont entre l’homme et l’homme ? Tout ce temps donné à la souffrance. Tout ce temps passé sans aimer. Tout ce temps perdu, sans comprendre, sans savoir. Tout ce temps passé à souffrir pour que naisse l’inconnu. Tout ce temps épandu pour des semailles qui ne seront pas les miennes. Ce sang qui continue sa course vers le caniveau, ce sang donné à l’autre que je ne connais pas. Cet autre qui me laisse sans défenses. Cette boue envahissante qui détruit l’image de ceux qui me sont chers, m’investissant jour après jour tel une place forte aux abois, pour enfin prendre possession de mon corps.
Solitaire, toujours, il me faut marcher et marcher encore, porter ces pierres de plus en plus lourdes pour mes épaules qui me paraissent, chaque jour, s’affaiblir un peu plus.
Combien de temps, de sang, de fatigues, combien de désespoir, de plus en plus présent, pour suivre une lumière qui s’éloigne toujours et, peut-être, disparaîtra ?
Pour quelle raison devrais-je me laisser dépecer, écraser, mettre en pièces ? Pour un but que je n’atteindrai pas ? Pour une clairière qui ne sera pas mienne ? Pour une source qui ne m’abreuvera pas ?
Me faudra-t-il longtemps penser en solitaire ? De là, sans doute, viennent mes terreurs. Suis-je un pessimiste heureux de vivre ou bien un optimiste qui doute ? Suis-je autre chose que le produit d’une éducation, d’une civilisation, de la peste noire, du hasard, d’un canular intergalactique ? J’aimerais bien savoir !… Ce n’est pas une obsession, mais, tout de même, j’aimerais savoir !
…
Bruits de vague dans un cerveau qui brûle. La vague est unique, solitaire, comme nous le sommes tous. Cette vague, qui n’est composée d’aucun élément matériel, me lave et me transforme. Elle entre par une brèche que je ne soupçonnais pas. Je me connais si mal ! J’avais besoin de la lumière du jour. De la voir. De la sentir. De la comprendre. De m’en imprégner. De la posséder de nouveau. J’avais besoin de refaire connaissance avec la vie, avec les hommes, avec la nature.
Combien de temps, de sang, de boue, d’amour, combien d’espoirs trahis, combien d’amis tombés, combien de souffrances acceptées, pour qu’une main se tende, effaçant le temps, le sang, la boue, ne laissant que l’amour ?
…
Il n’y a pas de bleu dans ma forteresse. La mer et la montagne me manquent. Le soleil aussi. Les néons ne parviennent pas à le remplacer. J’ai besoin de lumière, comme une fleur, je ne connais rien de plus stupide qu’une fleur, surtout sur papier peint… Là, sans doute, réside le secret de ma faiblesse, j’ai peur d’être stupide. Je connais pourtant des imbéciles heureux. Ils ne doutent pas. J’ai toujours considéré le doute comme le seul rempart réellement efficace contre la médiocrité, mais il s’agit aussi d’une ombre qui cache le soleil.
Peut-être me faut-il refuser de douter ? Peut-être faudrait-il que tout le monde refuse le doute ? Peut-être faudrait-il le faire disparaître de la surface de ce monde ? Ce serait beau !… Alors viendrait la lumière, déferlant comme ces vagues d’équinoxe, changeant nos impuretés en puretés nouvelles, ne laissant nul vivant, sur la terre, identiques à ce qu’il fut. À ce moment viendraient la peur et le chaos, dévoilant l’autre aspect de nous-mêmes, le plus dangereux, car la peur nous suit pas à pas. Elle nous accompagne depuis la naissance. Elle nous force à courir vers notre point d’éclatement, nous oblige à rompre nos amarres, nos liens, avec la raison.
Mes rencontres sont des chasses. Je me brûle à mon propre brasier. Je m’autodétruis sans vraiment le comprendre. Je me perds dans les méandres de mon imagination. L’ombre de l’amour, heureusement, me rappelle à la réalité. J’aime une salamandre, la douceur de sa peau, la profondeur de son regard. Toutes les femmes aimées ont un regard profond. Toutes les femmes trahies pleurent dans ma mémoire. Toutes les femmes que j’ai aimées arrivaient en retard. Toutes auraient mérité d’être trahies.
…
Pourquoi n’aimes-tu plus le vent ? disait-elle lorsque nous nous vîmes pour la dernière fois. Je croyais alors que rien de ce qui la concernait ne pouvait être aimable encore, et elle me paraissait pourtant être l’univers. Les forteresses de la passion ouvrent les portes du désir.
Je brûlerai mes vieux habits, détruisant mes chairs mortes et inutiles, afin de m’alléger. Je libérerai mon imagination et découvrirai ainsi une logique nouvelle. J’aurai besoin, alors, d’avancer en pleine lumière et de reconnaître, dans cette clarté, qui naguère me laissait apeuré, ma propre image en mouvement. Il me faudra aussi, sans voir, sans entendre, sentir la vie couler sous mes doigts, la suivre dans ces contrées vierges encore, l’approcher tout doucement, comme pour un animal craintif le ferait l’homme qui le chasse, à la recherche de sensations neuves, inusitées et non pas à la poursuite d’une proie. Sans voir, sans comprendre, sans entendre, comme dans un rituel d’enfant, il me faudra apprendre mes sens, les sentir, les pénétrer, les habiter et ne plus être qu’un œil, une oreille, un cerveau. Il me faudra, ensuite, dépasser ce stade, je deviendrai une part de l’univers, une parcelle de la vie (ne fût-ce qu’un instant).
Il me faudra, ensuite, aller plus loin. Suivre ma route sans tracer de chemin. Progresser en confiance sans chercher à connaître le but. Fermer les yeux, tendre la main et sourire, sans même m’en apercevoir, comme dans une danse, comme dans un jeu. Et puis, sentir approcher le rivage, avant même de le voir, sentir son souffle épouser ma respiration. Découvrir enfin que rien ne m’est étranger.
…
Alors, et alors seulement, je pourrais avancer, enfouissant mes pieds nus dans la chair de cette terre nouvelle. Je ramasserai un grain de sable, l’un de ces innombrables et minuscules points qui construisent la terre. Je m’apercevrai qu’il est unique et pourtant identique aux innombrables grains de lumière composant l’univers. Je me reconnaîtrai en lui, qui est une partie de mon existence, de même que je fais partie de lui. Il n’y a pas de frontière entre ce qui bouge et ce qui est inanimé. Nous ne sommes jamais totalement seuls.
Dans la lumière, je pars, je n’ai plus peur.
…
Peut-être est-ce la mort
Ou l’idée de l’oubli
Ou bien celle de voyages
Au long court, sans doute
Qui nous pousse à partir
Un peu plus chaque jour
Vers ce festin sanglant,
Ce plaisir douloureux,
Qui nous ouvre parfois,
Telle une bête morte,
Les entrailles offertes
Aux passants affamés.
Peut-être est-ce la vie
Ou la prégnance du vide
Ou nos terreurs nocturnes,
Plaisirs inavoués,
Qui nous poussent à offrir,
À qui le voudra prendre,
Le chant de nos peurs,
Le parfum de nos doutes,
Nos rencontres fortuites,
Nos chasses éphémères,
Nos violences refoulées,
Courses vaines, dérisoires,
Jusqu’au cœur de la vie,
Au tréfonds de notre être.
…
Peut-être est-ce l’espoir
Ou l’ombre de l’amour,
La douceur d’une peau,
Le souffle d’un sourire,
La promesse d’un plaisir neuf,
L’angoisse, sans cesse renouvelée,
D’une rencontre qui nous laisserait éblouis,
Le corps vide de toute demande.
Peut-être est-ce l’instinct de la bête,
Morte mille fois sous les assauts de la raison,
Mille fois revenue à la vie, portée par le désir.
Peut-être est-ce l’idée de l’infini,
Ce chant profond et grave
Que murmurent les étoiles,
Qui nous donnent la force,
Ces ailes sans matière.
Et nous porte,
Un peu plus chaque fois,
Au-delà de notre mémoire,
Au plus près de notre âme
Dans la chair même de la vie.
…
11
Une route étroite longe le bord d’un ravin, plus bas danse une rivière, dansait serait plus juste, l’hiver est là, la rivière est gelée. Une femme, qui fut jeune il y a peu, avance lentement. Elle est nue, mais ne le sait pas. Elle erre ainsi depuis des années. Jadis, sans doute, eut-elle une famille, mais le souvenir s’en est allé comme, d’ailleurs, le reste de sa souvenance d’une vie de femme. Chez elle, l’humanité n’est plus qu’une apparence. Tout au moins est-ce ce que pourrait croire l’observateur impatient.
Elle fut voyageuse, épouse et mère. Les enfants ont vieilli, orphelins recueillis par de lointains parents à l’affection mesurée, mais réelle. La voyageuse perdit la mémoire lorsqu’elle fut détroussée et violée par des brigands de passage. Son époux fut tué. La mort aurait pu la prendre. Elle s’en abstint. Sa destinée, sans doute, était autre. Des passants l’ont aperçue. Elle était, souvent, en compagnie d’ours. Aujourd’hui, l’ours a disparu de cette partie de la montagne. La femme est morte internée, depuis presque deux siècles. Elle fut, d’ailleurs, intégrée à des mythes millénaires.
Ici, le temps ne compte pas, ou, plus précisément, ne se compte pas. Les passants, touristes, promeneurs des villes et villages proche venus en voisins chercher le silence ou les champignons, les bergers, les contrebandiers du siècle précédent, les guerriers perdus, les anciens dieux, depuis longtemps oubliés, se croisent sans se reconnaître.
…
Le temps ne saurait suivre les règles de la raison. Il n’est strié, zébré, découpé en tranches fines et inconsistantes que dans l’imagination figée, comme on le pourrait dire, d’un plat de basse gastronomie où la viande se trouverait ensevelie sous une mauvaise graisse épaissie par le froid…
L’horloge est la banquise qui tua cette femme devenue ourse. Je parle ici de sa véritable mort. Celle qui vint à bout de son existence et non celle qui suivit sa vie. Le temps réel échappe à l’analyse de la façon même qui le fait incompatible avec toutes formes de comptage.
Le temps est une interrogation perpétuelle… Est-il route ou précipice ? Ou bien… Je ne sais et ne tiens pas à savoir. Tout ne doit être expliquer. Le sens procède d’une étrange géométrie !… Je veux dire : le sens de la vie, de ce qui me paraît être la vie mais peut n’être, en définitive, qu’une illusion. Je veux dire (aussi) le sens de la vie – sa direction, sa trajectoire – et non sa signification… La signification est préoccupation de grammairien, de comptable, de juriste… Le sens, seul, occupe les artistes, ces enfants en devenir.
Suis-je un artiste ? Je l’ignore. J’écris et pourtant ne me vis pas écrivant. Je ne suis pas à l’affût du geste, qui, en lui-même, ne présente nul intérêt, puisque répété chaque jour, depuis des mois, et qui serait, si je lui accordais ne serait-ce qu’une importance infime, comme une mise à mort sans cesse renouvelée. Je ne suis, ni le taureau, ni l’épée.
…
Alors pourquoi écrire ? Pour raconter, me raconter, créer, inventer, m’inventer, me construire, m’exprimer, exprimer ?…
Pour aucune de ces raisons. Je n’aime pas les histoires et ne me veux point biographe, ce taxidermiste de la littérature… Et je ne suis pas dépourvu de mémoire au point d’oublier l’ennui profond et somnifère que me causèrent tant de fâcheux insipides et bavards. Quant à l’invention, elle serait mon quotidien si j’étais sourcier, chercheur de trésors enfouis ou scientifique (peut-être). Je ne suis point, non plus, bâtisseur, et ne suis à la recherche d’aucune thérapie libératrice !…
Alors, pourquoi écrire ? Pour vivre autrement dans un temps, ainsi qu’un espace, différent de celui que je parcours quotidiennement, comme tout animal social.
L’ourse est revenue. Une balle l’a tuée. Mourir peut devenir une habitude. Sa fourrure est suspendue à la branche d’un arbre. Sans doute n’est-ce pas l’unique branche de cet arbre, mais le fruit nouveau venu – la fourrure – lui donne un poids, une importance particulière. La peau de l’animal, lorsque celui-ci est d’essence mythique, est porteuse d’une vie qui nous échappe.
Le feu n’aurait pu enflammer l’homme vêtu de la peau d’une salamandre. Embraser me vint d’abord à l’esprit, mais il est un monde entre la flamme qui brûle et l’illumination née de l’embrasement. Derrière, sans doute, se profile l’ombre d’une embrassade. Ombre double, en fait, puisqu’il s’agit de celle d’un couple enlacé.
…
J’aime une salamandre que je ne connais plus. Je me trouvai au cœur d’un brasier. Elle fut ma délivrance. Je crus l’aimer. Nous confondons souvent amour et reconnaissance.
J’aime une salamandre que je ne connais plus. Je veux dire : je connais mon amour pour elle parce que j’ai conscience de ne pas la connaître, car nous ne connaissons que ce que nous comprenons, que ce que nous contrôlons.
La fontaine s’est tarie, la montagne demeure. Mon regard se brouille et ne peut plus rien saisir. La fin d’une histoire, fut-elle de papier, ressemble à la mort. L’illusion reste toujours souveraine. Je tiens ma vie au creux de ma main. Nous devons inventer notre vie si nous avons le désir de vivre.
L’amour est un long vertige.